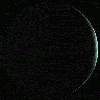
| chercheursduvrai.fr |
 Aide Aide
 Recherche Recherche
 Membres Membres
 Calendrier Calendrier
|
| Bienvenue invité ( Connexion (Log In) | Inscription (Register) ) | Recevoir à nouveau l'email de validation |

 To view this board in english, you must be registered.
To view this board in english, you must be registered.   |
LightInWay |
Ecrit le: Samedi 09 Août 2014 à 14h28

|
||||||
|
Unregistered |
EDIT: ensemble de ce document en deux parties en un seul PDF ici: L'ensemble de ce document en PDF ici: https://www.chercheursduvrai.fr/stockage/li..._Bouddhiste.pdf ---- Cosmogonie bouddhiste - dérivée de l'hindouisme Le bouddhisme Introduction (synthèse de propos tenus par Gyotsu à Lily Eversdijk, moine bouddhiste japonais) Il est utile de lire le sujet suivant pour bien comprendre celui-ci : https://www.chercheursduvrai.fr/forum/in...?showtopic=1713 Le bouddhisme est une réforme de l’hindouisme, c’est donc une religion dérivée de l’hindouisme (le Bouddha Gautama était né dans une famille princière de l’Inde hindouiste et tout son peuple était hindouiste, il a construit autre chose en partant de cette base dans laquelle il vivait). A ce titre, le Bouddhisme reprend des grands thèmes de croyance de l’hindouisme(réincarnation, karma) mais avec des changements importants malgré tout (pas d’atman, âme immortelle ; pas de Dieu Unique avec qui fusionner pour se réaliser). Le Bouddha n’a pas parlé d’un être suprême et a rejeté l’idée que l’être humain possède un noyau comme l’Atman. Donc il n’a pas admis l’existence de l’âme divine ou éternelle aussi bien pour l’homme que pour quoi que ce soit d’autre. Il a nié l’existence de l’éternité de quoi que ce soit, fût-il matériel ou immatériel. La notion de « Moi » n’est donc pas reconnue par le Bouddhisme. A la place il parle du principe de conscience d’un être, principe instable car la configuration humaine va et vient continuellement ; on est un nouvel homme à chaque instant ; plus celui du passé. C’est une série de fuites dans le court moment présent dans lequel on n’est plus celui de l’instant passé précédent. Cette fuite permanente donne l’impression de continuité à la vie selon les principes Bouddhiques. Un bouddhiste ne peut pas être un yogi car il ne cherche pas à réunir son âme immortelle (Atman) au Dieu éternel et Absolu ; l’absolu n’existe pas dans le bouddhisme. Au leu de suivre la voie du yoga que suivent les hindouistes, les bouddhistes suivent « La Noble Voie Octuple » afin de libérer l’homme de la souffrance. Petit historique sur le Bouddha (synthèse de propos tenus par Gyotsu à Lily Eversdijk, moine bouddhiste japonais) Gautama (nom qui lui a été donné une fois adulte) était le prince Siddhârta (nom de naissance), né en 623 avant J.C., à qui il avait été prédit, dès sa naissance, qu’il serait soit un très grand illuminé, un Bouddha, soit un très grand souverain. Son père le préserva de toute sagesse en le coupant de la réalité des souffrances à l’extérieur du Palais, voulant faire de lui le grand souverain héritier du royaume, lui faisant voir la vie seulement du côté idyllique et dans l’ignorance totale du fait que le peuple ne vivait pas idylle et la paix permanente. Un jour, Gautama (qui était adulte et avait pris ce nom d’adulte ; qui venait d’être marié avec une princesse par son père et eût un fils avec) quitta en cachette son palais qu’on lui avait toujours empêché de quitter depuis sa naissance, et découvrit la réalité extérieur des souffrances du peuple ; de la vieillesse, de l’infirmité, de la pauvreté ; et sur ce il fût choqué et décida de libérer les hommes de la souffrance. Ne sachant comment faire, il rencontra un moine hindou qui lui parla de renoncement aux plaisirs terrestres pour obtenir l’illumination, ce qui a semblé être la voie pour lui, afin de trouver quoi faire dans son désir ardent de libérer les hommes de toutes ces souffrances. Il abandonné son royaume, femme et enfant et parti méditer, à l’âge de28 ans, mortifia son corps ; suivant la voie yoguique la plus dure et la plus raide dans son désir d’obtenir l’illumination. Il parcouru le pays à la recherche de réponses, de rencontres avec d’autres moines et n’obtint aucune réponse, mangeant ce qu’il pouvait mendier. Il médita pendant des années et les privations ainsi qu’un jeûne de très longue durée de son corps le rendirent squelettique. Il s’affaiblit. Puis il prit conscience qu’il était tombé dans excès à l’autre (opulence au Palais et privation totale dans sa retraite de mortification) ; et alors il médita là-dessus et en émergea l’idée qu’il fallait suivre la « Voie du Milieu » ; une voie qui serait un juste équilibre entre les deux excès. Il médita sur cette voie durant plusieurs années, assis sous un ficus à Bodh-Gaya appelée « le pipal » et là il fût tenté par le démon (Mara), par les désirs et plaisirs suscités à lui par Mara ; mais il résista et il devint « Eveillé » après 6 ans de méditation ininterrompue sous le pippal. Il devint alors « Bouddha » (=Illuminé, éveillé). Enseignement du Bouddha (synthèse de propos tenus par Gyotsu à Lily Eversdijk, moine bouddhiste japonais) Il enseigne que tout le monde peut atteindre ce même état, qui l’a mis dans un état de joie et de paix intérieure ; et donc enseigne qu’il faut suivre le même chemin pour obtenir la même paix et le même bonheur : voilà le moyen de libérer les hommes de cette souffrance qu’il avait découvert. Il enseigne que toute personne doit vivre en suivant le Dharma (mot sanskrit qui veut dire « vérité », mais qui était utilisé par Gautama pour signifie « La Loi » ou ordre cosmique des choses qui obéît aux lois du karma, les causes produisent des effets). Selon son enseignement, chacun doit accepter son Dharma et le vivre et ne pas chercher à plaire à un être suprême. En vivant authentiquement, l’individu peut chercher à se libérer de ses souffrances, en arrivant à la Vérité Absolue. Lorsque l’individu s’est libéré de toutes ses souffrances, il vit dans un état de paix et béatitude constant appelé « Nirwana », qui n’est donc pas un lieu (comme les occidentaux le traduisent souvent comme le Paradis ou le « Ciel », une dimension d’habitation de Dieu ; non pas du tout), mais un état d’être de l’individu qui s’est affranchi de ses souffrances. Le Nirwana n’est ni le bien, ni le mal ; ni les deux à la fois, ni aucun des deux. Le Nirwana est un état d’esprit de paix suprême, la « sortie du feu des désirs, haines, convoitises, etc ». Pour arriver à cet état, il faut suivre la voie donnée par le Bouddha dans son enseignement (celle qu’il a suivi et explique donc aux autres), appelée la « Noble Voie Octuple ». Les quatre piliers fondamentaux de l’enseignement du Bouddha sont les quatre notions à bien comprendre : 1) Duhkh, le mal-être, la souffrance 2) Anatma, le non-soi (donc la non-possession d’une âme immortelle) 3) Anitya, l’impermanence (donc le fait que rien ne dure plus qu’un instant, apparaît, puis disparaît aussitôt) 4) Sunya, le vie (ce qui est vide de tout attribut, et rempli néanmoins de la plus grande potentialité possible). Concernant Duhkh, tout est douleur : 1) La naissance 2) La maladie 3) La vieillesse 4) La mort 5) L’union avec ce que l’on n’aime pas 6) La désunion d’avec ce qu’on aime 7) Les désirs Concernant les désirs, si ils ne sont pas satisfaits, la souffrance apparaît, mais si ils sont satisfaits, la souffrance apparaîtra ensuite car la satisfaction du désir n’est pas permanente, elle doit prendre fin et ceci provoque donc la douleur à ce moment-là. Bouddha a aussi énoncé les « Quatre Nobles Vérités », à savoir: 1) L’existence de la souffrance 2) La cause de la souffrance 3) L’extinction , la libération de la souffrance 4) La voie qui mène à la libération de la douleur, au Nirwana Et enfin Pourquoi la voie qui mène au Nirwana est appelée la « Noble Voie Octuple », car elle comprend : 1) Le point de vue juste 2) La conception juste 3) La parole juste 4) L’action juste 5) Le moyen d’existence juste 6) Les justes efforts 7) Les pensées justes Le Bouddha était d’abord hindou et il a reconnu comme exactes les lois du karma qui sont enseignées en hindouisme. Il reconnaît aussi comme exacte la réincarnation, mais en réfutant une âme immortelle qui se réincarne : c’est un principe de conscience qui reprend une forme incarnée ; donc cette forme consciente disparaît puis apparaît à nouveau dans une incarnation ; mais sans parler de transmigration d’une âme immortelle d’un corps à un autre. Toujours selon notre moine bouddhiste dont les informations servent à cette synthèse, dans chaque époque importante vient un Bouddha, Gautama ayant été le 7ème à avoir atteint cet état. Ce Bouddha est l’incarnation de l’amour-compassion et celui attendu pour notre époque, à venir, est appelé « Maitreya ». Note de l’auteur du document (moi) : En ce qui me concerne, ce n’est donc qu’un jeu de vocabulaire, car c’est bien la même « forme consciente » qui revient, avec ses acquis précédents et s’incarne ; et réfuter l’existence d’une âme immortelle qui transmigre pour dire que quelque chose d’impermanent revient mais avec le même contenu mémorisé est juste une façon paraphrasée de dire la même chose en disant qu’on ne dit pas la même chose. Au final, la « croyance » en une âme immortelle ou pas ne change rien si on en décrit les mêmes effets de fonctionnement… Donc c’est une différence qui se veut importante qui en ce qui me concerne est une non-différence. Cela revient par exemple à dire que je réfute l’existence de l’étoile qu’est le Soleil, mais qu’il existe bien une boule de gaz qui produit de la chaleur dans le ciel et située très loin de nous autour de laquelle nous orbitons. Mais attention, je dis qu’une étoile n’existe pas, car c’est ma croyance (pourtant je viens exactement de décrire ce qu’est une étoile, donc si c’est juste pour éliminer de la terminologie, ça ne présente à mes yeux aucune différence ; c’est une question de croyance superficielle). Par contre, pour ce qui est du fond, du refus de l’existence d’un principe éternel subsistant, on peut se poser des questions : pourquoi une telle opposition à ce grand principe supérieur de l’étincelle divine ? On peut se demander si c’est bien ce qu’il a dit, ou la manière dont cela a été compris, peut-être est-ce dû aux deux d’une façon ou d’une autre ? Le rejet de l’âme éternelle : une incompréhension
Le Soi que connaît l’Adepte est donc le Soi inférieur ; et il peut, pour beaucoup, se séparer du Soi supérieur, qui reste donc distinct de ce corps d’énergie qui constitue le principe de conscience s’incarnant. Ce principe n’est pas éternel car il est un ensemble de corps (le physique qui meut à chaque vie, et des corps subtils qui perdurent d’une vie à l’autre pendant un certain nombre de millions d’année ; jusqu’à une fin de manvantara. Donc en effet, d’un certain point de vue, si on parle du principe conscient, il ne perdure pas ; mais il est relié à l’Atman qui lui est éternel. Alors pourquoi Bouddha aurait donné seulement une fraction de vérité, faisant rétention du reste ? Ce qui aurait conduit à une mauvaise interprétation ?
Le Boudha Gautama a donc en effet dévoilé seulement un morceau d’une information spirituelle qu’il avait acquise ; relative au soi inférieur, corps d’énergie qui persiste un temps seulement et qui disparaître à la fin du manvantara. Ce corps d’énergie (la coque astrale et mentale à continue à perdurer aussi longtemps qu’une énergie extérieure (alimentée par les personnes qui le lui en donnent aussi) lui permet de ne pas se désagréger en atomes subtils et conserver sa structure. C’est ce principe là qui n’est pas éternel et qui revient s’incarner. Car le Soi supérieur n’est jamais incarné : il est situé dans un ailleurs qui n’a ni espace ni temps, ne vit donc pas dans la durée ; et se branche à notre moi inférieur, qui se réincarne. Une fois l’état d’illumination totale effectué, le Soi supérieur se branchera sur d’autres types de corps subtils d’un autre niveau, lui permettant une évolution dans d’autres zones des non formes et de la non dualité ; l’atman utilisant d’autres coques et larguant les coques inférieures (comme la coque physique est larguée à chaque mort pour retour à la substance de son monde) : l’égo inférieur, le principe conscient. Gautama a en fait enseigné une partie d’un concept spirituel abstrait et de haut niveau adapté à des personnes peu capables de mental en ne laissant que ce qui lui a semblé nécessaire pour leur travail, et il a axe le coeur de son enseignement sur l’amour et la façon de le cultiver pour atteindre le nirvana. Comme le précise la Doctrine Secrète, ceci est une erreur karmique, car lorsqu’on est enseignant (et il avait bien la tâche d’être enseignant spirituel) on ne doit pas induire dans de faux principes fondamentaux même si c’est parce qu’on a trop simplifié pour permettre de se concentrer sur les façons de faire plutôt que sur le fond qui est derrière. D’ailleurs, la négation de l’âme immortelle, telle que comprise par ceux qui ont entretenu avec le temps la religion bouddhiste ; est souvent vue comme le fait que c’est une religion matérialiste (rien de persiste, pas de Dieu). Mais c’est dû à cette incompréhension initiale. Des éléments montrent d’ailleurs que les bouddhistes ont les éléments qui démontrent la propre contradiction entre leur croyance actuelle de ce qu’a dit Gautama et ce qui se disait à son époque :
On constate donc d’après les propos tenus d’époque et cités qu’en effet ils ne peuvent pas être compatibles avec une disparition du principe conscient une fois le Nirwana atteint. En fait la persistance après est même affirmée. Cœur de l’enseignement De mon côté, je dirai que tout ceci est de moindre importance ; car si au final il est mentalement intéressant de savoir pourquoi il y avait des dissonances là où il ne devrait pas y en avoir ; cela ne change rien à la seule chose importante : le travail qui est proposé aux hommes pour atteindre l’état le plus haut ; même si le but visé derrière l’obtention de cet état n’est pas compris également par les bouddhistes et ce que le Bouddha en avait vraiment compris. En effet, le but à atteindre est si éloigné pour le commun des mortels, qu’il aura bien l’occasion de voir si il avait mal compris en quoi il consistait vraiment quand il y sera parvenu ; l’enseignement pour les masses consistant à donner des moyens d’arriver vers ce but déjà ; ce qui est le gros du travail. Ensuite les vérités se dévoilent pour ce qu’elles sont vraiment à celui qui pourra les contempler de lui-même. Aussi, la discussion sur l’âme éternelle inexistante chez les bouddhistes, si elle avait intérêt à être en terme comparatif à des enseignements de fond qui en sont les racines ; ne change rien à l’intérêt des pratiques et méthodes spirituelles qui servent à parcourir la Voie. On pourrait résumer ça en « chacun peut avoir la croyance qu’il veut tant qu’au final il mène sa vie comme il fallait qu’il l’a mène pour arriver plus loin sur le chemin de l’évolution. » Le cœur de l’enseignement est en un mot « l’amour ». C’est en effet le chemin de compassion qui permet la façon juste de percevoir afin d’atteindre le Nirwana. Toutefois il faut voir qu’il n’existe pas UN bouddhisme, mais DES bouddhismes. Et ce qui est enseigné diffère. Les bouddhismes (résumé de propos tenus par le Lama Chinga, « Rimpoché » et représentant dubiuddhisme tibétain au Népal) Au Tibet, existait une religion appelée la religion Bon, un culte animiste. Ce culte a fortement influencé le bouddhisme qui a été importé dans le pays vers le 7ème siècle après J.C. et certains tibétains professent encore cette religion à part entière. Une secte bouddhiste intégrant la religion Bon fut créé, appelé les « Bon-po ». Le bouddhisme d’origine indienne (Gautama était né et avait enseigné en Inde) était arrivé par le Népal. Là il s’était fortement teinté de tantrisme, donc rendu assez impur par rapport à l’original. Mais les rhytes tantriques furent intégrés au bouddhisme. Le Lama Chinga lui-même indique qu’en plus de sa croyance au bouddhisme il croit aux dieux et aux démons (niés par l’enseignement Bouddhique). En 750 après J.C. Padmasambhava quitta l’Inde pour le Tibet et fonda le Lamaïsme, forme tibétaine du bouddhisme. Il fonda les monastères à travers le pays, dispensant l’enseignement du Bouddha. Ceux reçus à l’examen théologique recevaient le titre de « lama », sinon ils étaient appelés seulement « trapas » (élèves) toute leur vie. Les croyants du lamaïsme portaient tous le bonnet de couleur rouge, ils avaient droit à manger de la viande, boire de l’alcool, prendre femme et avoir des enfants. Il fut adopté comme religion en Mongolie, au Népal, au Sikkim et au Ladakh, dans des parties de la Chine et de la Sibérie. C’est au 14ème siècle après J.C. que la secte des bonnets jaunes fut créé, par Tsong Kha-pa : un ordre monastique réformé qui observait le célibat, l’abstinence, avec une discipline de vie sévère, ascétique (pas de viande, pas d’alcool et bien d’autres choses). On différencia donc l’ »Eglise jaune » et l’ »Eglise rouge ». Les deux continuent de co-exister. Note de l’auteur du document : La prochaine fois que vous verrez un moine tibétaine, vous ferez attention à la couleur de son bonnet. L’état du Tibet était théocratique et l’église officielle devint celle des bonnets jaunes ; même si les bonnets rouges continuaient à exister. Dans tous les monastères du Tibet, la direction est sensée être assurée par une personne qui se réincarne pour assurer la direction après sa mort, et on recherche son successeur réincarné à chaque fois. Ceci est vrai pour tous les monastères tibétains, et de même pour le Dalaï-Lama, qui assure la direction de toute l’Eglise (et donc aussi de l’Etat car il est théocratique). Dans ce pays, 1/5 des hommes décident de devenir moines, et les 4/5 restant se marient et la polygamie y a cours. Certains de ceux qui deviennent moines prennent le bonnet rouge et peuvent aussi se marier (et être polygames), de même que les femmes peuvent avoir plusieurs maris. Les bonnets jaunes ont un mode de vie absolument identique à celui des yogis hindous. Ils ne cherchent pas ce faisant, à unir l’âme immortelle (Atman) au Dieu Unique, mais cherchent à atteindre le Nirwana. Donc la finalité sur le papier est sensée différer, pourtant les moyens de l’obtenir sont strictement les mêmes : Vie ascétique, purification de leur esprit de tous les vices, de tous les désirs, méditation continuelle, de préférence dans la solitude. Exercices respiratoires réguliers car la respiration est reliée au mental, afin de disicipliner leur mental. Il existe des maîtres spirituels là aussi, qui sont plus avancés, et des pouvoirs occultes (nom donné aux « siddhis » hindous) se développent chez ceux qui commencent à acquérir une maîtrise. Les pouvoirs occultes développés ne doivent pas être exposés au public (identiquement que chez les yogis) et ils doivent continuer leur chemin avec humilité et modestie (comme les yogis). Les bouddhistes tibétains utilisent aussi le pouvoir des mantras, ils répètent le « Om Mani Padme Om » et indiquent le pouvoir du son pour libérer des énergies dans l’humain qui les pratique. Note personnelle : Bref, sur le papier ils ne s’appellent pas yogi, mais ils en ont l’exact même chemin. Voilà une des choses qui montrent bien que finalement la croyance en le but final n’est pas très importante à partir du moment où le chemin parcouru l’est par des méthodes qui vont avancer sur la Voie (et en plus on constate que ces méthodes sont identiques, rien n’est ré-inventé). Les 14 Dalaï-Lama En 1400 aux temps du 1er Dalaï-Lama, il avait été prophétisé qu’il se réincarnerait 13 fois de plus que cette vie, pour conduire sa religion ; soit 14 incarnations en tout. Ensuite ? Ensuite rien n’est dit, quelque chose de différent va s eproduire ! Né en 1935, le Dalaï-Lama actuel est la 14ème incarnation, donc le dernier de la prophétie des Dalaï-Lamas. Il est encore vivant et assure depuis 1959 la direction du gouvernement tibétain en exil installé en Inde. En 2011, une charte fut signée par le gouvernement tibétain permettant l’élection d’un premier ministre, permettant la retraite politique complète du 14ème Dalaï-lama, qui n’assure plus qu’une autorité de direction spirituelle. Intéressant de savoir que la prophétie de Malachie prédit que le dernier pape de l’Eglise est celui qui est en fonction dernièrement, après c’est la fin de l’Eglise catholique, et que le dernier Dalaï-Lama est celui qui est en fonction dernièrement aussi. Il y a une cohérence des prophéties qui montrent bien qu’on arrive à une époque charnière où de lourdes transformations auront lieu. On rejoint les prévisions de la théosophie, celles de B. Creme, celles de beaucoup de « channels », celle de la fin des mini-cycles du Védas. Alors, regardez-bien devant vous : nous sommes dans l’époque où cela arrive ! Faites-en sorte de n’avoir pas vécu à ce moment-là comme la masse de tous ceux qui n’avaient pas la moindre idée que quelque chose arrivait ! La cosmogonie Ici c’est très bien fait et tout y est dit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmologie_bouddhiste Etant donné l'importante déformation du simple concept d''âme immortelle dans l'information transmise simplifiée par le Bouddha au peuple, la cosmogonie ne semble pas très utilisable, surtout qu'elle est déjà vue par les bouddhistes comme de simples allégories à des éléments; et en rein une description réaliste de création. Est-ce que dans ces conditions on peut même parler de cosmogonie!? ---- SUITE à venir |
||||||
|
|
LightInWay |
Ecrit le: Dimanche 10 Août 2014 à 11h09

|
||||||||||||||||||
|
Unregistered |
...suite... --- Le bouddhisme ésotérique Qu’est-ce que c’est ? Un enseignement existe appartenant au Boudhisme ésotérique, ou Sagesse Secrète, et non au bouddhisme exotérique, ou philosophie religieuse de Gautama le Bouddha. Cet enseignement traite de toutes ces choses « subtiles » que Gautama n’a pas enseignées au grand peuple mais a enseigné à des disciples de haut niveau capables de les comprendre dans toute leur subtilité. On retrouve exactement le même genre de façon de faire qu’avec Jésus-Christ qui a enseigné des généralités simples au peuple mais a donné un enseignement spirituel bien plus poussée à ses disciples (les apôtres, et pas seulement eux, un petit cercle plus élargi). Dans les enseignements de Gautama Bouddha pour les disciples avancés, on retrouve toute la compréhension manquante sur l’âme éternelle et sur tout ce qui est fond spirituel avancé qui manque dans la religion propagée de nos jours pour les simples pratiquants. Je citerai une personne à ce sujet dans une discussion spirituelle:
Ni le Bouddha, ni Jésus-Christ n’ont été véritablement compris par le grand public dans ce qu’ils ont diffusé. Il ne reste que les grandes lignes des grands principes permettant à un peuple très loin de préoccupations spirituelles d’amorcer un virage dans le sens spirituel ; et d’ailleurs tous les discours ont été simplifiés a cet effet pour la partie publique. Il y a a toujours eu et il y aura toujours deux humanités : celle du grand public à sensibiliser et qui n’a aucun intérêt pour la spiritualité, et celle des disciples sur le chemin, quel qu’il soit et qui est capable d’une grande ouverture intérieure à des choses plus subtiles. Ce que les religions enseignent aujourd’hui n’est que le contenu (de plus modifié par les tenants de la religion dans le temps) de la partie grand public (exotérique). En fait, le bouddhisme du Sud (celui qui est né des migrations du bouddhisme depuis son foyer d’origine et qui s’est mêlé au tantrisme, qui est une forme de magie virant à la magie noire appelée "magie de la main gauche", en contrario de la magie blanche, la "magie de la main droite") contient seulement l’enseignement exotérique du Bouddha, les connaissances du peuple à ce sujet, rien du fond plus haut ; et c’est ce qui en a permis des dérives en se mêlant à ces religions et cultes locaux et donné le bouddhisme répandu actuellement dans la forme enseignée exotérique. Le bouddhisme du Nord est celui qui a été le foyer du Bouddha et est le gardien aussi de connaissances diffusées par Gautama Bouddha à de plus hauts adeptes : le bouddhisme ésotérique ; que le bouddhisme du Sud nie exister. Toutes citations après ces lignes prises de l’auteur H.P. Blavatsky qui avait fait des recherches (toutes référencées par les ouvrages archéologiques, lithurgiques ou autres disponibles dans les lieux comme la bibliothèque du Vatican, le British Museum et d’autres références du même genre, titres de livres et n° de page pour vérification des références citées données par l’auteur (que je n’ai pas reporte dans mes extraits.)
Des découvertes attestent donc de l’existence d’un enseignement occulte du Bouddha à certains disciples.
Le fond de doctrine spirituel était le même que le fond connu par les hindous, mais encore une fois, pas le fond « public », c'est-à-dire exotérique, mais le fond ésotérique (car tout ce qui est propagé publiquement du système hindou et de ses connaissances védiques n’est que la partie exotérique, là aussi de nombreuses connaissances de plus haut niveau sont détenues et conservées pour de plus hauts initiés. D’ailleurs, c’est souvent ainsi que cela marche, dans toutes les religions, il existe un ordre plus ésotérique qui conserve précieusement des documents d’un enseignement plus subtil réservé à ceux qui ont montré « patte blanche » car le reste du grand public ne saurait le comprendre. Le fond commun d’enseignement à tous les grands enseignements spirituels Ces contenus spirituels sont d’un fond commun avec ceux des Védas qui eux-mêmes proviennent d’un enseignement ésotérique mis au placard depuis des éons qui ressort partiellement à certaines époques pour diffuser de la connaissance spirituelle afin de guider des peuples. On peut dire que les Védas ou les textes ésotériques bouddhiques, comme le fond de connaissance kabaliste sont des extraits (avec une vision commune en rapport les uns avec les autres car extraits d’une même source) d’une connaissance bien plus vaste existant d’un passé bien plus lointain et qui donne des bribes du passé et des grandes connaissances spirituelles lorsqu’il le faut. Ces sources d’informations premières constitueraient l’équivalent de centaines de livres de connaissances denses et fondamentales si elles devaient être écrites ; et elles ont servi seulement partiellement, par diffusions de morceaux compréhensibles et exploitables par les hommes en fonction de leur avancée et de l’exploitation correcte qu’ils pourraient faire de ces connaissances. Le reste est volontairement masqué, et les gardiens de ces informations sont ceux qui décident à quelle hauteur et quand une révélation d’une partie peut être faite pour le bien général de l’humanité. La partie révélée de ces connaissances aux diverses civilisations passées est archivée dans de nombreux ouvrages gardés par des sociétés secrètes pour certains ; et gardés dans des lieux cachés, cryptes, grottes, lieux anciens maintenant sous la Terre à cause des mouvements géologiques, etc. Ces ressources contiennent des centaines de fois la connaissance révélée actuelle qui n’a conservé de façon exotérique (c'est-à-dire connu du public) qu’une partie de ces connaissances révélées aux hommes par les centaines de milliers d’années passés (et ces éléments révélés aux peuples passés ne constituent qu’une partie très faible de la connaissance de ce type que les gardiens conservent à travers les millions d’année pour diffusion lorsque cela est nécessaire). Autant dire que nous savons aujourd’hui presque rien de ce qui a été révélé, qui est gardé précieusement dans des archives ; dont par exemple le contenu a été ramené après les chutes Atlantes dans des lieux cachés au Tibet et en Egypte ; qui lui-même n’est qu’une petite partie de la connaissance cosmique connue des gardiens de notre planète ; et dont le contenu n’est révélé qu’à celui qui a l’évolution lui permettant de la comprendre et l’utiliser avec sagesse (donc pas l’homme du public). Les faits à propos du fond commun spirituel et les connaissances bouddhistes ésotériques Tourtes citations prises de l’auteur H.P. Blavatsky qui avait fait des recherches (toutes référencées par les ouvrages archéologiques, lithurgiques ou autres disponibles dans les lieux comme la bibliothèque du Vatican, le British Museum et d’autres références du même genre, titres de livres et n° de page pour vérification des références citées données par l’auteur (que je n’ai pas reporte dans mes extraits.
La citation fait la part de ce qui est avéré et de ce qui est on dit ; mais dans l’avéré on a déjà des informations solides. On trouve aussi des références montrant que sur les quantités de livres écrits par les grands enseignants spirituels ou relatant les enseignements de ces grands, et donc le nombre est référence dans certains ouvrages qui nous parviennent aujourd’hui ; on constate n’avoir que de l’ordre du 1% de reliquat… où est le reste ? Tout le reste ??
On trouve des références à des disparitions de ce genre pour des documents fondateurs d’autres religions, comme le christianisme, et le judaïsme et si la Torah raconte une genèse semblable à celle des védas (mais avec tellement de choses manquantes) et si la Kabbale juive a des informations orales bien plus conséquentes, c’est parce que tout ceci a un fond commun, dont on retrouve les traces, et on a même le nom de ceux qui ont effacé ces traces :
Alors on arrive au bouddhisme, bien sûr il ne fait pas exception :
Imaginez-vous : 76 000 livres disparus sur les 84 000 écrits sur l’enseignement du Bouddha… pas disparus pour tout le monde !! Les 325 livres fondamentaux du lamaïsme détenues par les bouddhistes du nord qui ne les partagent pas publiquement non plus. Autant parler d’enseignements réservés ! Ceux qui se sont montrés dignes du subtil par leur intérieur sont enseignés à ces sagesses dans certains monastères bouddhistes (Lamasseries) et ils sont enseignés à des connaissances supérieures à celles connues dans l’ensemble des fonds spirituels exotériques actuels (dont les Védas, qui ne sont qu’exotériques). De même chez les hindous :
Réservé ne veut pas dire interdit, simplement le monsieur tout le monde (de la religion en question ou pas) n’entendra jamais parler de ces informations dans leur contenu ; sauf si il suit un chemin initiatique personnel, une vois spirituelle de recherche et qu’il ressent alors le besoin de l’accès à ces connaissances, et contacte des hommes sages qui sont au fait de ces connaissances en partie et l’enseignent ; puis lui permettent par leur contact, si il est jugé pour utile pour lui, d’avoir accès directement à ces connaissances en l’envoyant là où ces connaissances sont conservées. Voilà pourquoi cela s’appelle des connaissances ésotériques. Toutefois elles ne peuvent pas être d’utilité pour faire progresser celui qui est seulement sur le début de la voie, c'est-à-dire la masse du public ; et certaines données peuvent être utilisées dangereusement pour des pratiques « magiques » de bas niveau si utilisées par des personnes peu conscientes ; donc cela est occulté. Seul ce qui est nécessaire au chemin de ceux qui en sont sur le début est dévoilé publiquement ; et pour les autres ils iront de par leur feu intérieur, si leur intérieur les y pousse car c’est une nécessité pour eux, à la recherche, et le « hasard » (qui n’en est pas un) leur permettra les rencontres permettant d’avoir accès aux connaissances qui pousseront leur esprit vers un chemin encore plus profond sur la voie. Cosmogonie ésotérique Si on en revient donc à la cosmogonie, elle est celle des données ésotériques ; et à ce titre est la perception de la même cosmogonie vue par les grands enseignements spirituels anciens : védiques et kabbalistes. Et eux-même ne sont que de petits aperçus d’une connaissance à ces sujets qui est détenue ailleurs. Je renvoie donc aux cosmogonies hindoues (védiques) et kabbalistes (hébraïques) pour les aperçus publics. Ce message a été modifié par LightInWay le Dimanche 10 Août 2014 à 11h15 |
||||||||||||||||||
|
|
LightInWay |
Ecrit le: Dimanche 10 Août 2014 à 11h28

|
|
Unregistered |
|
|
|
LightInWay |
Ecrit le: Samedi 16 Août 2014 à 11h57

|
|
Unregistered |
Pour ceux qui veulent plus de détail sur la création historique des différentes branches des sectes bouddhistes; et leurs implantations:
http://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/lamaisme.htm |
|
|
LightInWay |
Ecrit le: Jeudi 05 Mai 2016 à 12h34

|
|
Unregistered |
Voilà des informations sur le Bouddhisme: les fondamentaux sous forme abrégée et concise qui présente ce qu'est le bouddhisme:
http://www.amitabha-terre-pure.net/bases_b...terre_pure.html Et ici aussi, présentation des éléments de façon concise: http://www.bouddhisme-universite.org/decouverte Les enseignements donnés par le Bouddha (toujours sous forme de discussions) sont appelés Soutras. En voilà: http://www.venerabilisopus.org/fr/livres-s...ses-sermons.pdf |
|
|
|
Ecrit le: Dimanche 18 Septembre 2016 à 15h01

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 5107 Membre n°: 199 Inscrit le: 23/02/2007 |
Le DALAI LAMA censurées de youtube http://www.europe1.fr/international/a-stra...youtube-2849272
"Chers amis, Youtube a banni les chaînes de l'événement pour des raisons que nous ne connaissons pas". Sur le site officiel dédié à la visite du dalaï-lama à Strasbourg, les organisateurs des conférences ne s'expliquent pas les raisons pour lesquelles le géant américain a censuré les vidéos du chef spirituel tibétain. Est-ce pour celà? https://www.upr.fr/actualite/31-mars-1959-3...i-lama-du-tibet |
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres:
 |
   |
[ Script Execution time: 0.0454 ] [ 12 queries used ] [ GZIP activé ]




