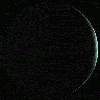
| chercheursduvrai.fr |
 Aide Aide
 Recherche Recherche
 Membres Membres
 Calendrier Calendrier
|
| Bienvenue invité ( Connexion (Log In) | Inscription (Register) ) | Recevoir à nouveau l'email de validation |

 To view this board in english, you must be registered.
To view this board in english, you must be registered.| Pages: (87) « Première ... 57 58 [59] 60 61 ... Dernière » ( Aller vers premier message non lu ) |    |
|
Ecrit le: Dimanche 22 Novembre 2009 à 16h07

|
|
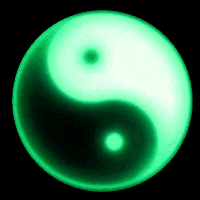 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 4296 Membre n°: 276 Inscrit le: 11/06/2007 |
Hello Tous, Hello Labo
Pour ce qui est des relations d'incertitudes de la relativité, en fait c'est assez simple..Pour observer quelque chose, il faut l'éclairer. Si on éclaire un ballon de foot lors d'un match de nuit, pas de problème, on peut observer sa trajectoire sans trop de problème avec une bonne précision. Par contre, si on veut éclairer des ballons de foot de 1 milliadième de mm (atomes, particules), et que le phton de lumière fait aussi 1 milliardième de mm, y a comme un problème, car le photon qui sert à éclairer la particule est aussi gros qu'elle et la perturbe, change sa position, lui donne de l'énergie, etc .. d'où l'impossibilité d'observer quoique ce soi avec précision au delà d'une certaine constante de quantum d'énergie qu'on appelle constante de Planck .. (ou mur de Planck).. Pour ce qui est de l'ether, voir dans la bible dont je vous ai fourni le lien, les pages 1-14 à 1-16 où les inventeurs prétendent que l'utilisation de volants d'inertie permet de mettre en mouvement l'ether environnant (énergie locale) et en retirer un bénéfice immédiat par un COP > 1.. Nous devrions aussi pouvoir mettre en mouvement cet ether à l'aide d'énergie électromagnétique (champs tournants, pulsations unidirectionnelles, etc). Bien évidemment ces domaines sont à explorer expérimentalement, car aucun ouvrage de la science officielle, ni manuel actuel scolaire, ne nous aidera, étant donné qu'il y a une chappe de plomb dans ce domaine, pour les raisons merchantiles (ah ce sacré fric drogue dure!!) que tu cites dans ton post.. On a enfermé volontairement la connaissance dans une limitation et une stratégie de perdant (selon ces manuels il ne peut y avoir que conservation ou pertes de rendement dans les systèmes de transformation d'énergie).. En fait, il n' y a de limite que celles que l'on s'impose !! A plus Nous vaincrons !! -------------------- Peuple de France, tranche dans le lard en sachant faire une addition des voix Vote à 100% pour Mélenchon, le seul qui parle de paix et de partage des richesses |
|
Ecrit le: Jeudi 26 Novembre 2009 à 17h56

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Suite des aventures de l'éther sur le blog de Paul Jorion. Nadine dit : 25 novembre 2009 à 23:51 @LABO343 On sent que vous la voulez l’explication et bien la voilà, j’espère qu’au moins j’aurais un merci. Au moment de la connexion la réactance de la bobine s’oppose au passage des électrons de la borne – vers la borne +. La batterie fournit l’énergie nécessaire pour franchir cette barrière -> IL Y A CONSOMMATION D’ENERGIE. Au moment de la déconnexion, la bobine s’oppose à l’ouverture du circuit et prend le relais de la batterie (pour un temps très court) en se comportant comme un mini générateur qui continue à pousser les électrons vers la borne + en passant par le circuit de sécurité du relais statique -> IL Y A AUSSI CONSOMMATION D’ENERGIE. C’est tout! Ma réponse: Nadine. Je constate que vous excellez dans l’art d’enfoncer les portes ouvertes. Ce que vous dites à propos de la phase croissante du champ magnétique est évident et je l’ai toujours observé. Ce que vous dites à propos de la déconnexion est évident au niveau du sens de circulation de l’énergie : l’énergie circule dans le meme sens que pendant la croissance du champ magnétique. Mais il faut amener encore une fois une précision là-dessus. La phase de déconnexion (à vide) dure environ une milliseconde et sa consommation supplémentaire Est de l’ordre de 0,5 ampère en valeur moyenne exprimée sur la durée totale de la période de fonctionnement. Pendant cette meme période de fonctionnement, la croissance du champ magnétique consomme selon une intensité moyenne de 8 ampères, soit une puissance moyenne de 96 watts. Il est interessant de comparer ce chiffre avec la puissance moyenne consommée par le processus de déconnexion, qui est de 6 watts. Je précise que la tension d’alimentation est de 12 volts continus. Conclusion : à vide, mon test consomme 96 watts au titre de la croissance du champ magnétique plus 6 watts au titre du processus de déconnexion. Cela fait 102 watts qui disparaissent néanmoins sans laisser de trace. En charge, la consommation due au processus de déconnexion disparait car la tension induite dans la bobine primaire tombe immédiatement en dessous de 48 volts : il ne reste donc que 96 watts consommés. Ce que je vous demande, sans réponse aucune, c’est la destination de la somme des énergies consommées. Le détail de ces énergies, je le connais parfaitement. Par contre la destination est « inconnue » en dehors de la perte ohmique d’une bobine de 0,012 ohm traversée par une intensité moyenne de 8 ampères, soit une chute de tension de 0,096 volt et une puissance moyenne de 0,768 watt. Il n’y a pas de rayonnement électromagnétique observé ni de puissance accoustique produite signifiante. Nous avons un test qui peut ainsi débiter une puissance de l’ordre de 96 watts dans « rien » pendant des heures. Ce « rien » est donc doué d’une capacité de stockage apparemment sans limites. Ce « rien » c’est l’éther. Ne me remerciez pas de vous ouvrir enfin les yeux : c’est tout naturel. Vous allez donc devoir passer aux vérifications matérielles et ensuite aux révisions déchirantes de dogmes enfin démasqués. Bonne soirée. A plus... |
|
Ecrit le: Jeudi 26 Novembre 2009 à 20h56

|
|
 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 2064 Membre n°: 275 Inscrit le: 11/06/2007 |
Yeahhhh!
Farouche la Nado ! Finalement ces rencontres sur le blog de Paul Jorion, c'est plus gratifiant que les rencontres sur Meetic... Tu l'auras ! Tu l'auras un jour... En toute sympathie, pour ton flegme. |
|
Ecrit le: Jeudi 26 Novembre 2009 à 23h22

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
La question qui est posée est celle de la négation de l’observation qui dérange un ordre trop parfait. Le problème est que cet ordre vient de passer son seuil de déclin.
La remise en question est si profonde que tout ce qui y amène semble irréel. Les débats dans lesquels interviennent certains caractères portent à mon égard les stigmates du mépris venant de la certitude jamais contredite. C’est regrettable. Mais je suis serein : rien ne peut contredire l’observation de faits précis, vérifiables et renouvelables à souhait. Leur diffusion est déjà acquise. Laissons maintenant cheminer les esprits. A plus… |
|
Ecrit le: Vendredi 27 Novembre 2009 à 07h45

|
|
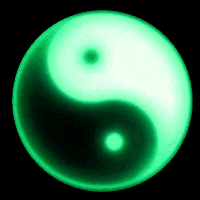 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 4296 Membre n°: 276 Inscrit le: 11/06/2007 |
Hello Tous et Labo
Bravo Labo, tu as réussi à ébranler le dogme des "scientifiques officiels". Mais Nadine réattaque, la saga continue .. Je la questionne sur la place de l'Esprit dans la science.. va t'elle répondre ?? A plus -------------------- Peuple de France, tranche dans le lard en sachant faire une addition des voix Vote à 100% pour Mélenchon, le seul qui parle de paix et de partage des richesses |
|
Ecrit le: Vendredi 27 Novembre 2009 à 11h52

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Dans mon test, à vide, l'ampèremètre indique un sens unique au courant :celui de la décharge de la batterie. Ce sens est confirmé par la courbe d'intensité à l'oscilloscope : à aucun instant il n'y a trace de courant inverse "vers" la batterie. Il faut toute la force d'un dogme pour refuser de voir cela. C'est la quantité colossale de conséquences de mon test qui bloque les esprits formatés. Cela va jusqu'au refus de voir le réel. C'est pénible. A plus... |
|
Ecrit le: Vendredi 27 Novembre 2009 à 14h17

|
|
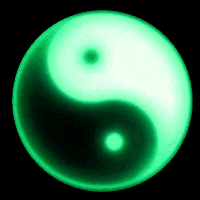 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 4296 Membre n°: 276 Inscrit le: 11/06/2007 |
Hello Labo
La gretchen semble dire que l'énergie se transforme en effet joule dans la batterie, mais que ça ne se voit pas, car certaines réactions endothermiques (qui consomment des calories) se forment à l'intérieur de la batterie sans la recharger et ramènent la température à une moyenne basse.. Enthalpie = niveau d'énergie (une sorte d'énergie potentielle intrinsèque de l'élément ou des composés) Exemple: Na (sodium) + H20 --> NaOH (soude) + 1/2H2 + chaleur. Na a une enthalpie plus grande que NaOH (soude) car on a perdu de la chaleur dans la réaction et il faudra refournir de la chaleur ou de l'electricité à NaOH pour retrouver Na (sodium). Le seul moyen d'en sortir, à mon avis est de faire le test avec un transistor hacheur haute tension sans diode de protection et de commutation suffisamment lente (100µs) pour ne pas créer de surtension de coupure de bobine trop élevée, de regarder l'indication de l'ampèremètre et la durée de décharge de la batterie préalablement pleine. Et de refaire l'expérience en mettant une diode de protection en inverse entre emetteur/collecteur ou source/drain du transistor et réobserver l'ampèremètre et la durée de décharge .. Enfin, peut être!!?? Qu'en penses tu Quartz, faisable, pas faisable pour la bonne santé du transistor, sachant que la bobine va réagir à la coupure ?? Houla !! ça devient complexe, dans son post concernant l'atome dont on sépare le proton de l'électron, Nadine doit parler de l'énergie d'ionisation: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_d'ionisation Que gagne t'on en arrachant l'électron au proton ? On doit gagner des charges électriques isolées qui ne sont plus neutres) d'où un potentiel électrique qui va permettre la circulation des charges .. Alors, là Léon Hatem se retourne dans son lit, car pour lui le proton et l'électron sont des petits aimants qui orbitent l'un autour de l'autre en harmonie de rotation synchrone de leurs pôles respectifs et en les arrachant l'un à l'autre, on crée de la dysharmonie et donc du desordre.. Merci, à plus -------------------- Peuple de France, tranche dans le lard en sachant faire une addition des voix Vote à 100% pour Mélenchon, le seul qui parle de paix et de partage des richesses |
|
Ecrit le: Vendredi 27 Novembre 2009 à 15h29

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Suite des aventures de l'éther. Nadine dit : 27 novembre 2009 à 13:00 @LABO343 Je n’échappe pas au débat j’essaie de vous aider, je vais vous poser un petit problème pour avancer dans la compréhension de votre expérience. Vous avez un atome d’hydrogène constitué d’un proton chargé + et d’un électron chargé -. L’atome proton et électron est neutre. Vous fournissez une énergie pour séparer l’électron du proton. Où est passé l’energie ma réponse : Si l’on parle d’un évènement unique, on peut penser que l’énergie est « logée » au sein du phénomène indiqué, sous une forme ou une autre. Dans le cas d’une bobine d’inductance, si l’on s’arrete à la simple croissance de son champ magnétique, on pourrait penser que l’énergie consommée pour obtenir ce champ est « logée » en son sein, sous la forme de son niveau d’induction magnétique. Soit. Mais dans mon test il est question d’évènements successifs et cela change tout. En effet on ne peut plus dire que l’énergie est stockée dans la bobine d’induction lorsque celle-ci est déconnectée sans étincelle et reconnectée ensuite dans un cycle sans fin. Je précise que la bobine est connectée pendant 3 millisecondes puis déconnectée pendant le meme laps de temps et qu’ensuite on recommence. La tension d’alimentation est au départ de 12 volts courant continu, qui devient une tension rectangulaire et non sinusoidale. Si l’énergie était stockée dans la bobine et puisque aucune énergie n’apparait à l’extérieur On devrait avoir une accumulation de l’énergie dans cette bobine, au fur et à mesure de chaque cycle d’alimentation. Le résultat en serait une hausse de l’induction magnétique de 0,7 tesla à chaque cycle d’alimentation, soit une induction de 1,4 teslas au bout de 9 millisecondes après la première connexion. Au delà de ce temps on rentre en zone de saturation magnétique et la réactance d’inductance disparait. La conséquence est que seule la résistance ohmique s’oppose à la tension d’alimentation et ainsi l’intensité atteindrait 1000 ampères pour une tension de 12 volts et une résistance ohmique de 0,012 ohm de la bobine. On voit bien sur la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=pSZMu6bDH5M que la bobine n’explose pas au bout de la première seconde de connexion en fonctionnement à vide. Force est donc de constater que l’énergie qui est effectivement consommée dans la batterie n’est pas stockée dans la bobine primaire ni dans le circuit magnétique. Cela veut dire que l’énergie a circulé avant chaque déconnexion de la bobine primaire et en l’absence de rayonnement. Elle s’est donc déversée dans « rien », alias l’éther. Seul un test en réel vous le fera admettre, j’en ai bien peur. A plus... |
|
Ecrit le: Vendredi 27 Novembre 2009 à 16h39

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Rebonjour à tous.
Un détail en passant sur la chaleur dans les batteries. Dans les voitures électriques on trouve un circuit de refroidissement pour les calories dégagées par la décharge des batteries. Si les réactions chimiques de la batterie généraient du froid, je ne pense pas que les constructeurs alourdiraient leurs engins avec un refroidissement spécifique des batteries. A plus... |
|
Ecrit le: Samedi 28 Novembre 2009 à 00h06

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonsoir à tous.
Suite des aventures de l'éther. 1. Nadine dit : 27 novembre 2009 à 20:54 @LABO343 Vous n’avez pas répondu à la question, c‘est pas grave. Je vous propose d’aborder le problème différemment, si votre batterie possède une résistance interne de 0.01 ohms (je pense que c‘est de cet ordre), quelle est la tension qu’il faut appliquer au circuit pour que circule un courant de 8 Ampères (si le reste du circuit ne possède pas de résistance)? Réponse: 0.08 volts Comment peut on trouver 0.08 volts si la batterie fait 12 V? Dans votre expérience ces 0.08 volts, c’est la tension moyenne générale du circuit qui correspond à la force électromotrice de la batterie 12 V moins la force opposée contre électromotrice de la bobine. La batterie étant un générateur de courant et non pas de tension, il lui faudra 10 heures environ pour se décharger complètement. Cela vous convient-il comme explication? Répondre 2. Amateur dit : 27 novembre 2009 à 22:50 Merci.. Donc, avec la batterie, si on alimente une résistance chauffante on transforme 960 wattheures en chaleur.. et si on alimente une bobine, on ne transforme que 6,4 wattheures ?? Euh !! grattons nous la tête .. Ma réponse Effectivement, je pense que la batterie de 12 volts et 80 Ah a une résistance interne de l’ordre de 0,01 ohm. La résistance ohmique de la bobine primaire est de 0,012 ohm et la résistance ohmique du relais statique est de 0,007 ohm. Les câblages sont assez gros pour être négligés. La résistance de mesure de l’intensité qui alimente l’oscilloscope peut être déconnectée et la mesure se fait alors sur l’ampèremètre à aiguille dont la résistance interne est quasi nulle. Lorsque je parle de consommation à vide de 8 ampères, je n’y inclus pas la consommation parasite de la déconnexion qui est de 0,5 ampère. Ainsi on peut dire que la consommation totale à vide est de 8,5 ampères sous une tension absolument constante de 12 volts. Mais simplifions et retenons votre hypothèse de départ :une résistance ohmique de 0,01 ohm laissant passer un courant de 8 ampères. Je précise encore que cette intensité est une valeur moyenne et que cela correspond à une courbe de progression quasi rectiligne de zéro à 32 ampères pendant 3 millisecondes, suivi d’une intensité nulle pendant 3 millisecondes de plus. Je mets de coté les 0,5 ampère de la perte dans la déconnexion. De toute façon le résultat est identique à une intensité moyenne de 8 ampères. Poursuivons votre raisonnement. La chute de tension obtenue est donc de 0,08 volts. Cette chute de tension signifie bien qu’une contre tension s’oppose à la tension de la batterie, bien qu’étant légèrement inférieure. En fait cette contre tension est maximale à l’instant du début de la connexion de la bobine primaire et baisse ensuite de façon linéaire jusqu’à la déconnexion. Si on poursuivait la connexion de 6 millisecondes supplémentaires on dépasserait la « zone rouge » de la saturation magnétique de la tôle au silicium et l’intensité exploserait brusquement. Jusque la tout est clair et conventionnel. Mais quand vous dites que la batterie est un générateur de courant et non un générateur de tension, là il y a un gros problème car la tension de la batterie est partie prenante de la vitesse de croissance de l’intensité. En effet, si vous vous contentez de connecter l’alimentation au moyen d’un seul élément de 2 volts, vous aurez une vitesse de progression de l’intensité diminuée au pro rata de la chute de tension aux bornes de la bobine primaire. Le résultat sera que l’intensité crête atteinte en fin de séquence de connexion sera 6 fois plus petite et que l’énergie qui pourra être puisée par la bobine secondaire sera diminuée dans la même proportion. La tension d’alimentation est bien un élément fonctionnel de la puissance consommée à vide dans la bobine primaire. La consommation n’est donc pas constituée par la seule résistance ohmique. Si c’était le cas, alors le fonctionnement en charge serait d’entrée miraculeux car on aurait une courbe de consommation à vide et en charge strictement identiques et ne représentant que la résistance ohmique, tout en produisant 100 watts effectifs sur la charge. N’oublions pas que la séquence de connexion de la bobine primaire est totalement isolée dans le temps par rapport à la séquence de décroissance du champ magnétique pendant laquelle la bobine secondaire est connectée sur la charge. La seule liaison entre les bobines est le niveau atteint par l’induction magnétique dans le circuit magnétique. N’oublions pas que ce test consomme la même intensité à vide et en charge et que le premier « trouble » est ici. L’énergie est transférée dans l’éther au pro rata de l’intensité consommée et au pro rata de la contre tension d’inductance. Ce transfert est donc progressif et son maximum correspond à l’instant précédant la déconnexion de la bobine primaire. La quantification de ce transfert se fait bien selon la formule de « l’énergie contenue dans une inductance » mais le stockage de l’énergie ne se fait pas dans le circuit magnétique qui ne pourrait supporter une croissance indéfinie de son induction magnétique. De la même façon mais à l’envers, l’énergie circule depuis l’éther à chaque décroissance d’un champ magnétique. Cependant il y a une différence importante : il n’y a plus d’inductance dans une bobine soumise à un flux décroissant. C’est cette différence qui peut être une source d’asymétrie dans la circulation de l’énergie avec l’éther. C’est la piste que je suis. A plus... |
|
Ecrit le: Samedi 28 Novembre 2009 à 14h11

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Les aventures de l'éther, suite, mais le niveau baisse. 1. Nadine dit : 28 novembre 2009 à 10:21 @LABO343 Avant de vous lancer dans une explication fumeuse où l’éther à une position centrale il faut épuiser toutes les autres solutions conventionnelles. Pouvez vous expliquer l’expérience très simple ci dessous qui est équivalente à la votre sur le problème que vous soulevez? Un circuit composé uniquement de deux batteries montées en série et en opposition dont chacune a une résistance interne de 0.01 ohms. La première batterie a une force électromotrice de 12V et la seconde une force contre-électromotrice (puisque monté en opposition) de 11.9 V . En appliquant la loi d’ohm : I=U(bat1)- U(bat2)/résistance inter (bat1+bat2) I=01/0.02=5Ampères Pour 80 Ah pour chaque batterie avec un courant de 5 ampères sous une tension générale du circuit de 0.1 volts, les deux batteries seront déchargées au bout de 32 heures et l’energie consommée sera: Energie=puissance x temps =0.5×32 = 16 Wh Vous avez sous les yeux une expérience équivalente à la votre mais beaucoup plus simple. Les deux batteries se sont vidées pendant 32 heures pour une consommation d’energie de seulement 16 Wh Pas besoin d’éther, la loi d’ohm suffit pour expliquer l’expérience! Etes vous d’accord avec ça? PS:Dans votre expérience pouvez-vous me donner la valeur de la tension moyenne (avec un voltmètre classique) aux bornes du circuit batterie +bobine si c‘est possible? Répondre Ma réponse. Je crois que vous ne comprenez pas bien la notion de circulation de l’énergie. Je pense que vous ne connaissez pas grand-chose non plus à l’usage des batteries. Ce test que vous me décrivez là est simplement la recharge d’une batterie par une autre. De plus la différence de tension entre les deux batteries est de 0,1 volt : cela veut dire que la charge de la deuxième par la première ne va pas durer bien longtemps. Dès que les tensions se seront égalisées le courant de charge de la première cessera. On sera bien loin dela décharge complète de la première batterie qui devrait amener sa tension par éléments à 1,8 volts, soit 10,8 volts au total. Dans l’égalisation de la charge de deux batteries il y a simple transfert d’énergie de l’une à l’autre sans autre perte que la minuscule perte ohmique qui peut les concerner. Les deux batteries ne peuvent évidemment pas etre connectées en série sans que leurs meme poles soient en opposition (+contre + et – contre -) sinon cela donnerait un magnifique court circuit. Il n’y a aucune espèce de comparaison avec mon test dans lequel la batterie est effectivement vidée si la connexion est maintenue pendant au moins 10 heures. Veuillez trouver des comparaisons moins fumeuses pour vos démonstrations : le niveau baisse. Bonne journée. A plus... |
|
Ecrit le: Samedi 28 Novembre 2009 à 14h26

|
|
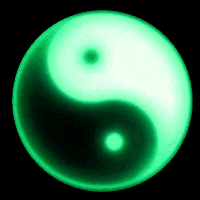 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 4296 Membre n°: 276 Inscrit le: 11/06/2007 |
Hello Tous, Hello Labo
Ah ah ah ah .. Attention, elle va te sortir une batterie dont la fcem ne monte pas plus haut que 11,9 volts !! Si on la suit, les électrons ne feraient pas le même effort selon le circuit qu'ils parcourent.. quelles feignasses ces électrons dans les bobines !! A plus -------------------- Peuple de France, tranche dans le lard en sachant faire une addition des voix Vote à 100% pour Mélenchon, le seul qui parle de paix et de partage des richesses |
|
Ecrit le: Dimanche 29 Novembre 2009 à 09h10

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Suite des aventures de l'éther sur le blog de Paul Jorion. Désormais nous sommes dans l'escamotage. Le débat sur la réalité de la décharge de la batterie a déjà eu lieu dans ce forum. Le concept de Nadine est de dire que l'énergie ne disparait pas dans la bobine mais qu'il n'y a pas consommation "reelle" dans la batterie. Pourtant elle est bien déchargée et les wattheures qu'il faut pour la recharger sont bien réels. Donc on a une énergie réelle pour obtenir la recharge de la batterie et on nous dit qu'il n'y a pas d'énergie dépensée dans sa décharge. Là on est dans l'illusion pure. A plus... |
|
Ecrit le: Dimanche 29 Novembre 2009 à 10h36

|
|
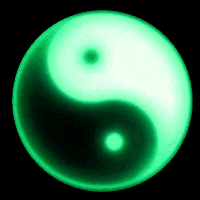 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 4296 Membre n°: 276 Inscrit le: 11/06/2007 |
Hello Tous Hello Labo
Dans la tête à Nadine, c'est peut être qu'on utilise mal les électrons, il vaut mieux qu'ils chauffent une résistance, plutôt que de faire mumuse dans un tobogan en spirale.. ?? A plus.. On est pas bien payé, mais on se marre bien !! -------------------- Peuple de France, tranche dans le lard en sachant faire une addition des voix Vote à 100% pour Mélenchon, le seul qui parle de paix et de partage des richesses |
|
Ecrit le: Dimanche 29 Novembre 2009 à 18h12

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonsoir à tous.
Suite des aventures de l'éther. 1. Nadine dit : 29 novembre 2009 à 10:08 @LABO343 Je n’aime pas trop la mauvaise fois. Tout le monde peut se tromper et ce n’est pas grave, c’est comme ça que l’on progresse. Quand vous écrivez:« si vous branchez deux batteries de 12 volts en série en connectant le pole moins de la première sur le pole plus de la seconde vous aurez une batterie de 24 volts. Si vous connectez la borne plus de la première et la borne moins de la seconde ensemble, vous verrez bien ce qui vous arrivera si vous restez à coté. » Alors que vous avez écrit « Les deux batteries ne peuvent évidemment pas etre connectées en série sans que leurs meme poles soient en opposition (+contre + et – contre -) sinon cela donnerait un magnifique court circuit » Je trouve que c’est intellectuellement malhonnête de transformer vos dires (sans doute pour ne pas passer pour un farfelu). Pour le reste vous avez votre solution. Ma réponse : Je ne fais que vous citer. C’est vous qui parlez de batteries montées en série et en opposition. Evidemment la formulation est insuffisante et il vaut mieux décrire la chose plus précisément. Pour moi, à priori, deux batteries montées en série, cela veut dire que leurs tensions s’ajoutent. Par contre « montées en opposition » cela peut vouloir dire que leurs poles « plus » et « moins » se trouvent chacun face à face. Mais dans ce cas nous avons un montage en parallèle. Voici votre texte de référence : 1. Un circuit composé uniquement de deux batteries montées en série et en opposition dont chacune a une résistance interne de 0.01 ohms. La première batterie a une force électromotrice de 12V et la seconde une force contre-électromotrice (puisque monté en opposition) de 11.9 V . Au niveau de ce que j’ai écrit je ne retire rien car c’est l’exacte vérité. « Les deux batteries ne peuvent évidemment pas etre connectées en série sans que leurs meme poles soient en opposition (+contre + et – contre -) sinon cela donnerait un magnifique court circuit » Il y a un malentendu sur le terme « opposition » tout simplement. J’ai interpreté ce mot dans le sens que vous avez employé plus haut. J’ai compris que vous vouliez dire que les poles « plus » de chaque batterie se font face (sont en opposition) et sont connectés ensemble. La meme connexion devant se faire pour chaque pole « moins » tout simplement. C’est vrai aussi que deux batteries dont les poles « moins » sont connectés ensemble tout comme les poles « plus », c’est d’abord un montage en parallèle. Mais si une des deux batteries a une tension inférieure à l’autre cela devient un montage en série, le temps que les tensions s’égalisent par répartition de l’énergie. Pour le reste, surtout, vous meme n’avez pas de solution valide. Vous reportez la disparition de l’énergie sur la batterie sans pouvoir expliquer un instant ou se retrouve l’énergie qui a été effectivement consommée dans la charge de la batterie. Vous déplacez le problème, sans plus. Pour finir, vous dites à Amateur que : 1. Dans le test de LABO343 cette energie d‘opposition (consommée par le mini-generateur que constitue la bobine ) est fournie par la batterie elle-même puisque c’est elle qui est à l’origine du phénomène d’inductance. Le mystère est donc entièrement levé. Ainsi nous avons un « générateur qui consomme ». Je ne connais que des générateurs qui produisent. Le mot de générateur ne s’emploie que lorsqu’il y a un flux d’énergie qui circule DEPUIS ce générateur. La présence d’une contre tension dans la bobine primaire de mon test ne signifie pas qu’elle est un générateur puisque le flux d’énergie va VERS elle. Quant à l’inductance, elle existe, quel que soit le type de générateur utilisé pour l’alimentation, pendant la croissance d’un champ magnétique et seulement dans ce cas. A plus... |
|
Ecrit le: Mardi 01 Décembre 2009 à 09h15

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Les aventure de l'éther, suite. Nadine a posté une réponse dans laquelle elle revisite le système de charge des batteries qui se trouvait dans les voitures du temps des dynamos. Je suis en train de finir une réponse précise sur ce nouvel errement. A plus... |
|
Ecrit le: Mardi 01 Décembre 2009 à 12h06

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Rebonjour à tous.
Suite des aventures de l'éther : Nadine dit : 30 novembre 2009 à 20:58 @LABO343 @Amateur Le but de ce dialogue n’est pas d’avoir raison mais de comprendre ce qui se passe. Vous soulevez la question: peut on produire de l’energie à partir du vide en passant par-dessus le premier et second principe de la thermodynamique. Moi je dis non, mais ne sait on jamais. Pour bien visualiser le paradoxe et donc l’étudier facilement je vous ai proposé un test théorique beaucoup plus simple que le votre car je n’utilise pas de variation de courant continu, ni d’inductance. Je n’ai besoin que de deux générateurs montés en opposition cad un générateur de courant de 12 volts (la batterie) et un générateur de tension constante moins élevée que la batterie (on néglige la chute de tension de la batterie pendant la décharge). Je vous propose que ce générateur soit un moteur à courant continu d’une puissance de 12Vx10A=120 watts lorsqu’il fonctionne à plein régime, lorsqu’on le fera tourner à l’envers il deviendra générateur (dynamo) et fournira un courant opposé à la batterie. Sa vitesse de rotation inverse sera définie de telle sorte que la force contre électromotrice générée ne laisse passer que 10 ampères dans le circuit dans le sens pole – vers pole + pour les électrons. Première expérience: le moteur fonctionne comme un récepteur à vide, le courant qui circule dans le circuit est quasi nul, le peu qui circule est utilisé pour faire tourner à vide le moteur, la tension générale du circuit est aussi quasi nul -> ok avec Lavoisier Deuxième expérience: le moteur fonctionne en pleine charge, le courant qui circule est de 10 Ampères sous 12v, le moteur consomme 120w par heure soit lorsque la batterie est vide au bout de 8 heures 960 Wh. C’est 960 Wh n’ont pas disparu dans le vide puisque le moteur a effectué un travail. Cette énergie pourra par exemple s’être transformée en energie potentiel si le travail a consisté à remplir la citerne d’un mini château d’eau. -> encore ok avec Lavoisier Troisième expérience: on bloque le moteur et donc on crée un court circuit, l’intensité du courant est infini (disons énorme) et gramme le moteur. L’energie de la batterie s’est transformée en chaleur jusqu’à la coupure du circuit -> encore ok avec Lavoisier Quatrième expérience: on fait tourner le moteur à l’envers, on fournit donc de l’énergie extérieure autre que la batterie de telle sorte que la contre tension ne laisse passer que 10 Ampères dans le sens de la décharge de la batterie. Celle ci est complètement déchargé au bout de 8 heures (je vous rappelle qu’au fur et à mesure que le moteur tourne vite à l‘envers, l‘intensité diminue jusqu‘à 10 Ampères pour cette expérience) Si la résistance du fil est nul et que la résistance interne de la batterie est de 0.01 ohms il faudra que le moteur génère une contre tension de 11.9 Volts pour laisser passer 10 Ampères La puissance consommée par le circuit (je néglige la perte par effet joule du moteur): P=UI=1W Pour une batterie de 80Ah celle ci se videra au bout de 8 heures et l’énergie que recevra le circuit sera de P=Uit=8 Wh Ce montage vous paraît il correct , pouvez-vous le reproduire dans votre labo? La grande question : En quoi s’est transformé l’energie fournie au moteur pour le faire tourner à l’envers puisque le circuit ne consomme au bout de 8 heures que 8 Wh dissipés sous forme de chaleur dans la résistance interne de la batterie? Il n’y a pas de rayonnement électromagnétique puisqu’on travail en courant continu Le moteur ne doit pas plus chauffer que pour la deuxième expérience (10A) PS: un générateur consomme de l’energie pour pouvoir en fournir Répondre Ma réponse : Nadine. Je m’excuse de vous contrarier encore mais je confirme que vous ne connaissez pas la circulation de l’énergie. La machine en courant continu dont vous parlez peut avoir deux dénominations ( ou statuts) selon le sens du flux d’énergie qui circule par rapport à elle. Elle peut être un générateur ou bien un récepteur d’énergie. La différence de statut se détermine par rapport à la vitesse du rotor provoquée par la tension aux bornes de ce rotor, en l’absence de tout frein ou de toute poussée mécanique exercée sur son axe. Pour simplifier la démonstration il faut prendre une machine à courant continu à excitation indépendante ou bien à stator constitué par un aimant permanent. De cette façon nous considèrerons la seule force de Laplace, sans être dérangés par la variation éventuelle du champ magnétique du stator. Supposons donc une machine à courant continu alimentée sur son rotor par une tension de 12 volts. Le champ magnétique créé par le stator a une induction magnétique de 1 tesla, par exemple. En fonction du nombre de brins du rotor, cette machine va atteindre une certaine vitesse de rotation et s’y stabiliser strictement. Prenons pour exemple 1000 tours par minute. Nous avons là le fonctionnement à vide et si la résistance ohmique était nulle et si il n’y avait aucune perte par frottement mécanique, cette machine ne serait NI un générateur NI un récepteur (alias un moteur). En pratique, les pertes internes inévitables en font un récepteur. La machine ne devient un générateur QUE si la vitesse du rotor dépasse sa vitesse spécifique à vide : 1100 tours par minute par exemple. La hausse de la vitesse du rotor est fonction de la puissance fournie par cette machine en tant que générateur. La machine devient un récepteur QUE si la vitesse tombe en dessous de la vitesse spécifique à vide : 900 tours par minute, par exemple. Cette chute de vitesse est fonction de l’intensité de l’effort fourni en tant que récepteur (moteur). Le sens de rotation de cette machine est donné par la polarité de sa connexion avec la batterie et non par son statut. Je précise, à ce stade, que ceci n’a rien à voir avec la bobine primaire de mon test qui ne peut être QU’ UN RECEPTEUR car JAMAIS une inductance n’a de valeur supérieure à la tension qui l’alimente pendant la phase de croissance du champ magnétique. Votre comparaison n’a donc aucune pertinence car le phénomène de disparition de l'énergie se trouve dans l'inductance et non dans une machine à courant continu. Revenons à la machine à courant continu. Le fait de faire changer le sens de rotation de cette machine ne change pas son statut de générateur à récepteur ou inversement. La seule chose qui change c’est le sens donné géométriquement à l’action mécanique qui en sort (en cas de fonctionnement en moteur) ou alors de changer la polarité aux bornes du rotor (au cas ou on utilise le fonctionnement en générateur, c’est à dire en survitesse par rapport à la vitesse de référence). Dans votre montage, vous ferez griller le rotor en quelques secondes car vous irez au delà du « calage » du moteur à l’arrêt, face à une source de courant issue de la batterie citée. Vos trois premières expériences ne me posent pas de problème. La Quatrième, par contre est totalement incompréhensible. Je m’explique et en premier je vous cite : « Quatrième expérience: on fait tourner le moteur à l’envers, on fournit donc de l’énergie extérieure autre que la batterie de telle sorte que la contre tension ne laisse passer que 10 Ampères dans le sens de la décharge de la batterie. Celle ci est complètement déchargé au bout de 8 heures (je vous rappelle qu’au fur et à mesure que le moteur tourne vite à l‘envers, l‘intensité diminue jusqu‘à 10 Ampères pour cette expérience) » Que voulez vous obtenir ? Quand vous dites « on fournit de l’énergie extérieure » je suppose que cela signifie que la machine est utilisée en tant que générateur. Je suppose aussi que la destination de l’énergie fournie par ce générateur est la charge de la batterie, sinon je ne vois pas le sens du propos. Dans ce cas on commencera par exclure la rotation inverse de la machine et on cherchera à obtenir une vitesse de rotation supérieure à la vitesse de rotation à vide en connexion de cette batterie. C’est exactement ce qui se faisait dans les voitures avec les dynamos. A ce moment du processus il est très important de préciser que la charge de la batterie s’effectue parce que la tension aux bornes du rotor est SUPERIEURE à la tension aux bornes de la batterie. Si vous ne me croyez pas, demandez à un ancien garagiste de le confirmer. L’énergie fournie pour recharger la batterie sera fournie sur l’axe mécanique du générateur (par un moteur thermique par exemple comme dans une voiture ancienne à dynamo). La machine à courant continu à forces de Laplace est un simple échangeur de la forme de l’énergie sans aucune liaison avec l’éther. Mais ne vous avisez pas de tenter de faire tourner à l’envers une machine en courant continu dont le sens de rotation à vide est déjà défini par sa connexion avec une batterie. Si vous persistez dans l’erreur il vous en coûtera la destruction de cette machine en quelques secondes, au pro rata de l’absence de contre tension provoquée et de la seule résistance ohmique subsistant pour limiter le courant. Pour finir un générateur n’est pas un récepteur. Un récepteur consomme et un générateur produit. Peut être voulez vous dire qu’il faut une énergie extérieure, donc consommée elle même, pour faire produire un générateur. Certes, mais cette énergie provient de l’extérieur du générateur et non pas de l’intérieur, hormis les pertes mécaniques ou ohmiques, évidemment. L’énergie circule. Quand je dis qu’on peut retirer de l’énergie du vide, ce n’est pas une hypothèse : c’est une réalité de tous les jours dans les transformateurs. Le problème, c’est que la même quantité d’énergie va vers le vide, dans les transformateurs, et que donc la résultante est nulle. Ce que je me propose de faire c’est un système d’échange d’énergie asymétrique avec l’éther. J’ai déjà réussi à fabriquer la machine « à perdre de l’énergie ». Cependant vous conviendrez qu’il vaut mieux réussir à faire le contraire. A plus... |
|
Ecrit le: Mercredi 02 Décembre 2009 à 13h22

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous,
suite des aventures de l'éther, version mécanique. Nadine dit : 1. 1 décembre 2009 à 18:24 @LABO343 « Je m’excuse de vous contrarier encore mais je confirme que vous ne connaissez pas la circulation de l’énergie. » Ne vous inquiétez pas pour ça, je n’ai pas de connaissance particulière en electro-technique c’est la raison pour laquelle je rame un peu sur les expériences de pensée mais ça m’amuse beaucoup. Sur le fond je reste persuadée que votre interprétation est fausse et je vais refaire une tentative pour le démontrer. Comme vous le dites justement la technologie du moteur à courant continu ne peut pas être utilisée pour générer une force contre électromotrice inférieure à la batterie et c‘est bien dommage. Arrêtons provisoirement l’electro-technique, je crois que votre problème peut se comparer simplement à celui ci. Premiere expérience: Si je prends un corps et que je fournis une énergie mécanique pour le monter d’une hauteur h (ce qui correspond à une batterie en recharge), alors cette energie se transformera en énergie potentielle gravitationnelle E1 (pour la batterie =energie potentielle électrique). Lorsque je fais tomber ce corps, je récupère cette energie sous forme d’energie cinétique E2 du fait de sa masse et de son mouvement (pour la batterie c’est le courant électrique ). L’energie mécanique-> L’energie potentielle E1 ->l’energie cinétique E2 L’energie ne s’est pas perdue, elle n’a fait que se transformer. Deuxième expérience: Changeons les conditions pour se rapprocher de votre expérience: Avant de faire tomber ce corps on met en place un dispositif qui ralentit la chute (ce qui correspondrait à la force contre électromotrice). Ce sera un générateur de force (peu importe sa nature) qui consommera une energie E3 pour opposer à la chute du corps une force plus faible que la force gravitationnelle, le corps tombera donc moins vite. Avec ce dispositif le corps tombe lentement, l’energie potentielle E1 n’est que partiellement restituée sous forme d’energie cinétique puisque E2=1/2mv2 et v est faible. Quand le corps arrive au sol, l’energie dissipée (vibration + chaleur) sera bien inférieure à l’energie potentielle de départ contrairement à la première expérience Je résume: On fournit un travail mécanique pour monter le corps, ce travail se transforme en energie potentielle E1. On fait tomber la masse et on ralentit sa chute grâce à un générateur de force qui consommera une energie E3, l’energie cinétique E2 récupérée sera très inférieure à l’énergie potentielle de départ E1. Et vous, vous dites: où est passé la majeure partie de cette energie puisque je ne récupère presque rien de l’energie potentielle du départ même pas sous forme de chaleur, c’est forcement l’éther qui a aspiré tout ça? Est ce bien pour vous la nature du paradoxe? Si oui vous n’aurez pas de peine à comprendre où est votre erreur de raisonnement. PS: »J’ai déjà réussi à fabriquer la machine « à perdre de l’énergie » C’est pas plutot la machine à perdre son temps…c’était quand même interessant. Répondre o LABO343 dit : 2 décembre 2009 à 11:55 Je confirme que vous ne connaissez pas, hélas, non plus, la circulation de l’énergie dans sa forme mécanique. La comparaison que vous proposez, c’est le principe de la dissipation de l’énergie dans le freinage d’une masse soumise à l’accélération de la pesanteur. Prenons un exemple de la vie courante qui vous « parlera » mieux. Prenons une masse et élevons la à une hauteur donnée. La masse sera une voiture initialement posée au niveau zéro de la mer. A peu de distance de la mer se trouve une belle montagne de 3000 mètres de haut. La route amène jusqu’au sommet. La masse de la voiture est de 1000 kilogrammes. Supposons que nous ignorons les pertes parasites issues des pneumatiques, roulements, engrenages et pénétration dans l’air. Nous amenons la voiture au sommet. Elle possède ainsi une énergie potentielle par rapport à la gravitation. On décide de redescendre. On coupe le moteur, on met le « point mort » et on se lance. Que va t’il se passer ? La voiture va accélerer tant qu’elle n’arrive pas au point zéro. En arrivant au point zéro, ce véhicule sans pertes aura atteint une certaine vitesse qui définira une énergie cinétique égale à l’énergie potentielle qu’elle avait au sommet de la montagne. Mais voilà, la route comporte beaucoup de virages qu’il faut aborder à une vitesse maximale définie par la sécurité. Que faire alors ? Freiner, tout simplement. Et que se passe t’il lorsqu’on freine ? Il y a dissipation de chaleur et non de froid. Et d’ou vient cette énergie ? De la transformation d’une partie de l’énergie potentielle. La seule consommation d’énergie pour freiner est celle qui consiste à appuyer sur la pédale de frein. Si j’avais une voiture électrique comportant une machine en courant continu et que la batterie était chargée à fond avant de gravir les 3000 mètres de déniveau, il y a de fortes chances qu’elle serait quasi vide en arrivant au sommet. Mais , en descendant, je peux profiter du frein électrique qui consiste à faire tourner le moteur au delà de sa vitesse initiale de tension de service. Ainsi, il suffit de rouler en 3° vitesse alors que la vitesse de déplacement voudrait utiliser la 4° vitesse, pour recharger les batteries en descente. Bien sur il y a les pertes ohmiques mais à l’arrivée on a retrouvé tout ce que l’on a consommé moins les pertes de roulement. On comprend pourquoi les voitures électriques n’interessent pas trop les vendeurs de carburant (et de taxes ). J’ai observé le phénomène de disparition de l’énergie dans une inductance, lors de la croissance du champ magnétique. Je ne l’ai pas observé ailleurs. Votre démonstration ci dessus est fausse. C’est vous qui perdez du temps à vous accrocher à un dogme. Testez donc mon observation et avancons. A plus... |
|
Ecrit le: Mercredi 02 Décembre 2009 à 18h08

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
2 DECEMBRE 2009. Bonsoir à tous. Disparition de l’énergie à vide dans mon test : Influence de la bobine secondaire sur la bobine primaire. Dans mon test j’ai pris soin d’éliminer cette influence en utilisant les petits entrefers. Donc l’intensité qui parcourt la bobine secondaire n’a aucune influence sur l’intensité primaire. Cela reste cependant valable tant que la résistance de charge ne tombe pas en dessous d’une valeur critique. Comment peut- on alors valider la théorie classique qui dit que l’énergie ne disparait pas à vide ? En effet il faudrait que quelque chose de fondamental change entre le fonctionnement à vide et en charge pour « rester » dans la théorie classique de conservation de l’énergie. On est en face d’un système qui « retrouve » l’énergie consommée à vide dans le seul fonctionnement en charge. Pour rester dans la théorie classique il faudrait donc qu’il existe une manifestation extérieure de l’énergie consommée à vide et de plus que cette manifestation disparaisse totalement pendant le fonctionnement en charge car dans mon test la consommation à vide est égale à la consommation en charge. Ce n’est pas la perte ohmique car elle reste la meme à vide et en charge. Ce n’est pas un rayonnement hertzien car il n’est pas constaté et de plus ne possède pas son organe de pleine expression : l’antenne. Ce n’est pas le bruit car son amplitude ne change pas selon le mode de fonctionnement : seule change la forme de sa courbe sonore. On cherche donc quelque chose qui n’existe pas à vide et qui disparait ensuite en charge. Par contre avec la théorie de l’éther, tout fonctionne. A vide l’énergie circule vers l’éther. En charge l’énergie circule dans les deux sens : d’abord vers l’éther et ensuite depuis l’éther. La clé d’organisation qui gère la quantité d’énergie circulante est l’induction magnétique crete atteinte à l’instant de la déconnexion de la bobine primaire. Le non sens du stockage d’énergie répété dans le circuit magnétique en cas de fonctionnement à vide prolongé est résolu. Le fonctionnement à vide montre que la circulation d’énergie avec l’éther n’est pas obligatoirement symétrique. La piste que je suis est celle de la diminution du taux de transformation du champ magnétisant secondaire en flux effectif de contre effondrement, sans modifier le taux de transformation du champ magnétisant primaire en flux magnétique. A plus… |
|
Ecrit le: Mercredi 02 Décembre 2009 à 23h37

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonsoir à tous.
Fin de partie sur le blog de Paul Jorion. 1. @LABO343 Je n’adhérerai à votre théorie que lorsque toutes les explications conventionnelles seront épuisées. Arrêtez de dire ce que je sais déjà, ma démonstration est juste car le corps ne ralentit pas à cause d’un frottement quelconque, il ralentit grâce à un générateur de force (un champs de force) qui s’oppose comme l’inductance à la chute du corps en produisant une force opposé à la force de gravitation. Je n’ai pas défini ce générateur parce que je ne sais pas si on peut en fabriquer un. Votre test laisse passer 8 A sans dégager aucune chaleur c’est donc que la tension du circuit est très faible, c’est tout. Je vous rappelle que cette tension est faible parce que c’est le résultat de la force électromotrice de la batterie de 12 V – la force contre électromotrice que génère l’inductance de la bobine. En moyenne: Ucircuit= Ubatterie-Ubobine =RI=0.01×8=0.08 V (en négligeant les autres résistances) Répondre Ma réponse : Vous escamotez 96 watts dans une formule mathématique. Je crois que je n’ai plus rien à rajouter. a plus... ici. |
|
Ecrit le: Vendredi 04 Décembre 2009 à 11h56

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Il y a eu une réponse à mon dernier post sur le blog de Paul Jorion. Vu le contenu de la réponse, je ne pouvais pas rester silencieux. De plus, j'ai pratiqué le problème de la variation de réluctance, il y a longtemps. J'avais démonté une dynamo de voiture et j'en avais extrait le rotor. J'avais ensuite enlevé tous les brins de ce rotor en conservant intact le collecteur. Puis j'avais divisé le collecteur en 4 secteurs ou il y avait alternativement connexion avec la masse du rotor puis déconnexion et ainsi de suite. Je réalisais ainsi un espèce de jeu de vis platinées "batard" car les étincelles détruisent rapidement le cuivre des lames du collecteur. Ensuite j'avais raboté le rotor pour qu'il quitte sa forme cylindrique et qu'il prenne une forme ovale, définissant ainsi un système à variation de réluctance "vite fait". Il ne restait plus qu'à connecter les bobines du stator en série avec le collecteur modifié et la masse pour avoir un moteur à variation de réluctance opérationnel. C'est là que j'ai croisé le chemin de la contre tension issue de la baisse de la réluctance et la conséquence en a été que ce système se stabilise à un régime assez bas avec d'énormes étincelles au collecteur. Evidemment il aurait fallu diminuer le nombre de spires des bobines du stator pour obtenir une vitesse plus grande, mais alors l'intensité aurait explosé le collecteur. Je n'avais pas à l'époque le matériel électronique actuel. Voilà donc le débat et ma réponse: Nadine dit : 3 décembre 2009 à 18:59 @LABO343 Votre question de savoir où sont passé les 96 watts est légitime, mais la circulation de l’energie n’est pas si simple à comprendre et recèle beaucoup de paradoxe pour preuve cet exemple assez simple: Une batterie de 12 V alimente une bobine avec une résistance de 1.2 ohms il circule un courant continue de 10A et la bobine génère un champs magnétique constant. La puissance consommée est de P=UI=120Watts dissipé sous forme de chaleur par la résistance Le circuit étant bien fixé au sol on refait la même expérience mais avant de fermer le circuit on dispose à proximité de la bobine le long de son axe horizontal un corps métallique. On ferme le circuit, celui ci consomme la même puissance à savoir 120 Watts dissipés sous forme de chaleur dans la résistance par contre le corps métallique fournit un travail attiré par la force magnétique Si on fait le bilan energetique de l’ensemble du systéme batterie + bobine +resistance savez vous d’où vient l’énergie qui à permis de déplacer le corps métallique puisque la batterie n‘a pas fournit plus d‘energie que pour la première expérience? Et dans ce cas peut on dire que le champ magnétique est une reserve d’énergie potentielle? Répondre ma réponse : Je suppose que la bobine dont vous parlez est une bobine placée sur un circuit magnétique non clos ou encore mieux une bobine à air, sinon votre test n’aurait pas de sens. En effet un circuit magnétique clos, comme celui de mon test n’a aucune attraction sur des masses ferreuses extérieures. Ce que vous me décrivez est le phénomène de variation de réluctance d’un circuit magnétique. Une bobine à air ou bien un circuit magnétique « ouvert » à une tendance automatique à faire baisser sa réluctance , si une opportunité le lui permet. En l’occurrence , dans votre test, il s’agit d’une masse ferreuse disposée à distance d’attraction de cette bobine. Comme vous devriez le savoir la variation de réluctance est le siège d’une circulation d’énergie. L’énergie circule depuis l’éther et se dirige vers l’alimentation de la bobine lorsque la réluctance diminue et l’énergie circule depuis l’alimentation et va vers l’éther lorsque la réluctance augmente. Les tenants de l’absence de l’éther disent que l’énergie se stocke dans le champ magnétique sous forme de variation de son induction ( en teslas). Dans le cas de votre test il y a diminution de la réluctance. Donc il y a production d’énergie depuis l’éther. Dans la bobine il va y avoir croissance de l’induction magnétique puisque la réluctance baisse. La conséquence est qu’il va y avoir création d’une tension opposée à la tension d’alimentation, pendant le temps précis que va durer le déplacement de la masse de fer jusqu’à son point d’équilibre qui signifiera que la réluctance ne diminuera plus. Contrairement à la contre tension d’inductance, qui ne peut pas dépasser sa propre tension d’alimentation, la tension induite par la baisse de la réluctance est fonction de la vitesse de cette baisse de réluctance. Elle peut donc dépasser la valeur de la tension d’alimentation et recharger la batterie si c’est une batterie qui sert d’alimentation à la bobine. Tout ceci ne durera que le temps du déplacement de la masse de fer. Tant qu’il s’agit d’un phénomène qui ne se reproduit pas, on ne peut pas trop parler mais si on veut revenir à la position initiale de la masse, l’énergie qui a circulé dans un sens circulera dans l’autre. Le champ magnétique est pour moi une « clé d’organisation » qui gère la circulation d’énergie avec l’éther. Le niveau d’induction magnétique atteint est le pivot de cette circulation d’énergie. Nous en revenons toujours à l’observation que j’ai fait d’un phénomène concernant l’inductance et qui ne peut pas etre jugé par une formule mathématique mais par une autre observation. On n’enferme pas l’énergie dans un concept mathématique sinon on pourrait alors décider que l’on peut circuler en voiture avec les seules taxes TIPP en se passant de carburant : il suffirait d’une bonne formule pour y croire… Ce que je dis je l’ai vu. Je ne l’ai pas imaginé. A plus... |
|
Ecrit le: Samedi 05 Décembre 2009 à 10h26

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous.
Le débat continue sur le blog de Paul Jorion à propos de l'existence de l'éther. Je ne suis pas le seul défenseur de l'éther : il y a en premier l'auteur initial du blog. Nous n'intervenons pas sur le meme aspect de l'existence de l'éther. La particularité de mon intervention c'est qu'elle repose sur une expérience matérielle vérifiable à tout moment et en tout lieu. Le débat qui suit s'éloigne un peu de mon test mais on est toujours dans le domaine de la recherche de la surunité. Je ne fais que rappeler un test qui n'a pas abouti, il y a longtemps. Donc, en premier la réponse de Nadine : « Dans le cas de votre test il y a diminution de la réluctance. Donc il y a production d’énergie depuis l’éther. Dans la bobine il va y avoir croissance de l’induction magnétique puisque la réluctance baisse » « Production d’energie depuis l’éther » vous allez un peu trop vite pour moi. Dans mon test au fur et à mesure que le corps se déplace, il y a transfert de l‘energie cinétique en energie magnétique, ce qui se traduit par une augmentation de l’inductance de la bobine. La variation du flux magnétique pendant le déplacement du corps métallique entraîne une contre tension qui vient s’opposer à la tension de la batterie. En appliquant la loi d’ohm Ubat-Ubobine=RI, la résistance n’ayant pas bougé, c’est le courant du circuit qui diminue, la puissance dissipée du circuit (P=UI) s’en trouve donc diminué pendant le temps que dure le travail pour déplacer l’objet métallique. Au finale l’inductance de la bobine a augmenté (si on laisse le corps là où il est après son déplacement), ce qui signifie que l’energie magnétique (W=1/2LI²) a augmenté en proportion égale de l’energie potentielle magnétique initiale du corps métallique. En fin de course, l’intensité du courant I reprend sa valeur normale. La circulation de l‘energie du corps vers la bobine est: Energie potentielle ->Energie cinétique-> Energie magnétique qui vient s’ajouter à l’energie magnétique déjà stockée grâce à l’énergie électrique de la batterie. La question: Lorsque le circuit est ouvert, le corps métallique n’a aucune energie potentiel magnétique Ep=0, dés que le circuit est fermé le corps métallique acquière une énergie potentielle magnétique instantanément. D’où vient cette énergie potentielle à la fermeture du circuit? Il est évident que le corps ne capte pas de l’energie électrique en passant par le champ magnétique pour le transformer en energie potentielle sinon on observerait une chute de tension le temps de cette circulation d‘énergie, de plus je ne vois pas comment se ferait cette circulation. D’où vient selon vous cette energie potentielle soudaine lorsqu’on ferme le circuit en raisonnant en terme de circulation d’énergie? Si vous dites que cette energie est présente dés le départ et qu’il faut un champ magnétique pour qu’elle s’exprime je ne vois pas en quoi l’éther est utile pour expliquer le phénomène. Ensuite ma réponse : Pour ne pas être victime de la complication due à l’impact de la masse à son arrivée sur la position d’équilibre, il faut raisonner sur un système identique mais rotatif. De cette façon on évite les problèmes d’aller et retour de la masse attirée puis devant faire machine arrière. Il faut donc utiliser un rotor dont la forme cylindrique habituelle est transformée en un ovale Pour créer des zones successives de grande et petite réluctance. Ce rotor sera situé dans un stator du type des anciennes dynamos de voiture : bipolaire pour faire simple. J’ai construit une machine comme cela quand j’étais ado car je croyais qu’on pouvait obtenir un très bon Rendement en utilisant la variation de réluctance. J’ai croisé sur mon chemin la notion de contre tension induite issue de la variation de réluctance (dans le sens de diminution de la réluctance). Le résultat a été que cette machine n’accélère que pour arriver à une vitesse d’équilibre donnée par la résultante de la tension d’alimentation et la contre tension induite. Cela confirme deux choses : le moteur accède à une certaine vitesse et l’intensité initiale présente au démarrage diminue au fur et à mesure de l’accélération. Ce moteur fonctionne grâce à un système de vis platinées qui crée un contact à l’instant ou la réluctance est la plus grande et qui le coupe quand la réluctance est la plus faible. Dans mon très ancien test j’avais détourné l’usage du collecteur de cette dynamo de voiture pour créer ce système de distribution du courant. Lorsque le circuit est ouvert, le champ magnétique disparaît. Si vous utilisez un relais statique il n’y aura pas d’étincelle parasite. Il suffira d’attendre que le rotor arrive à la nouvelle position de réluctance maximale et ensuite on rétablit la connexion. Le rotor arrivera à sa nouvelle position en profitant de l’énergie cinétique acquise par sa vitesse. L’énergie cinétique du rotor est l’expression de sa vitesse et elle est issue de la phase d’accélération du rotor entre la position immobile et la régime de rotation constant acquis pour une tension d’alimentation donnée. La consommation du rotor baisse au fur et à mesure qu’il accélère et c’est pendant ce laps de temps que se fait le transfert d’énergie depuis la batterie vers l’énergie cinétique du rotor. Cela serait très difficile à observer avec un système non rotatif. L’énergie potentielle de la masse métallique ferreuse provient de la variation possible de réluctance (dans le sens de la baisse de cette réluctance) donnée par la position du rotor au moment du début de la connexion (de la fermeture du circuit). Dans ce cas on ne raisonne pas en terme de circulation d’énergie car il n’y a pas eu encore circulation à l’instant précis du début de la connexion de la bobine. La circulation d’énergie implique que l’on soit « dans » son action. S’il n’y avait pas de contre tension induite par la diminution de réluctance, le système accélèrerait en permanence. La conséquence serait que l’on pourrait obtenir un très grand régime de rotation en maintenant le même couple moteur (car il n’est dépendant que de la configuration géométrique du rotor). La conséquence serait que la puissance mécanique de sortie dépasserait la puissance ohmique seule consommée. De plus, en employant des bobinages supraconducteurs, cela se ferait dès le plus bas régime de rotation. Malheureusement la contre tension élimine cette solution et empêche la circulation asymétrique de l’énergie venue de l’éther. C’est pourquoi j’ai abandonné cette piste il y a longtemps déjà. Pour avoir un autre exemple il suffit de prendre un aimant permanent et un bout de fer posé non loin. L’aimant permanent va attirer le bout de fer et ainsi produire de l’énergie mécanique « depuis rien » par le même principe de la variation de réluctance. Pour revenir au point de départ il faudra consommer exactement la même quantité d’énergie mécanique. Bilan zéro. Vous comprendrez donc que le fait de tomber par hasard sur un bilan « autre que zéro » ne peut pas laisser indifférent. C’est ce qui se passe avec mon test MEG ou, hélas je perd de l’énergie. Mais il y a rupture de l’équilibre. Cela veut dire que c’est possible et on ne peut plus rester sans rien dire ni rien faire. Voilà, c'était ma réponse. Nous en sommes toujours au point mort par rapport à mon test MEG. J'espère que l'idée de la réplication l'emportera. On verra bien. En attendant aucune controverse ne s'avère pertinente. A plus... |
|
Ecrit le: Samedi 05 Décembre 2009 à 21h40

|
|||||
 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 170 Membre n°: 9855 Inscrit le: 07/01/2009 |
Bonsoir à tous, Bonsoir LABO, Je m' invite dans ton post, car le moteur JPC fonctionne aussi par variation de la réluctance. Certes de manière entièrement mécanique, mais en espérant ainsi échapper à la malédiction de la contre tension induite, ou plutôt contre action induite. Lorsque tu dis :
Le Roto-Commutateur agit de même. Et que tu finis en disant :
Alors là le Roto-Commutateur utilise 2,5 fois moins d' énergie mécanique. Le bilan n' est plus nul. Effectivement, comme toi, le fait de tomber sur un bilan « autre que zéro » ne nous laisse pas indifférents. Je pense que nous escaladons la même montagne par des voies différentes. A bientôt au sommet !!! A++ |
||||
|
Ecrit le: Samedi 05 Décembre 2009 à 23h05

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonsoir à tous,
Bonsoir Yatanagan. Je suis très heureux que le test de variation de réluctance que tu mentionnes fonctionne. De mon coté, j’ai abandonné cette piste il y déjà longtemps, à la suite du blocage du à la contre action induite (comme tu l’appelles). Mais dans ma tête je me suis toujours dit qu’un jour on trouverait une feinte pour passer à travers ce problème. Je vais prendre le temps de regarder ce test JPC de plus près. Comme tu as pu le constater, mon test MEG à vide soulève une polémique car il prouve l’existence de l’énergie du vide alias l’éther. Il semblerait qu’il en résulte beaucoup de conséquences théoriques dont je ne me doutais pas. En effet, jusqu'à présent j’étais polarisé sur l’aspect « crise de l’énergie » et pas plus. Je découvre le reste. A plus… |
|
Ecrit le: Samedi 05 Décembre 2009 à 23h21

|
|||
 Expert(e)       Groupe: Modérateurs Messages: 4027 Membre n°: 181 Inscrit le: 07/10/2006 |
Bonsoir à tous, Yatanagan, ton observation me semble à propos, Cela dit, il y a un élément de plus avec la commutation physico-mécanique du flux, il s'agit du comportement du fer vis à vis du magnétisme. Je vous joint un texte un peut long vous voudrez bien me pardonner, Il m'a été transmis par Tagor, la source en British est ICI. Il y est question de commutation de flux par variation de réluctance dans un alternateur. La traduction est faite par Mr Gueuguel..........
-------------------- Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie.
Page YouTube, Page Dailymotion, Album Picasa, La Force contre-électromotrice, simulation magnétique, Viktor Schauberger |
||
|
Ecrit le: Dimanche 06 Décembre 2009 à 09h08

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour à tous,
bojour Quartz. Le texte mis en encadré a l'air d'etre très interessant mais la traduction est parfois "inaudible". Difficile dans ces conditions de capter l'essence des concepts centraux de ce texte. Si quelqu'un parmi le forum connaissait bien l'anglais technique pour traduire le texte, ce serait formidable. Par exemple : Alternateurs Inductance composent d'un cœur sur le terrain avec du fer "jambes". Chacune de ces pattes est enveloppé par une bobine de fil. J'ai du mal à suivre. mais nous cherchions un moyen d'utiliser le perforateur "électrique" ou de tomber sur le terrain. Là aussi le poly-fils thermaleze, tourne suffisamment de fil de fer pour produire saturization magnétique là aussi tandis que l'intensité est proportionnelle à la durée de l'interface poteau. là aussi de l'utilisation de condensateurs dans le circuit de terrain. là aussi |
|
Ecrit le: Dimanche 06 Décembre 2009 à 09h14

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Excuses. Le post a été lancé incomplet par fausse maneuvre.
La suite : Ces «vibrations forcées" mai être très faible que vient aire le mot "mai" là dedans ? la suite : Le principe de son appareil est qu'il ne courait courant à travers les carottes aimant. la suite : cet éther est par nature dynamique et est unshieldable, ce qui rend impossible de créer une parfaite système «fermé». Merci d'avance à ceux qui savent de nous éclairer. A plus. |
|
Ecrit le: Dimanche 06 Décembre 2009 à 10h27

|
|
 Expert(e)       Groupe: Modérateurs Messages: 4027 Membre n°: 181 Inscrit le: 07/10/2006 |
Bonjour à tous,
Oui Labo, c'est pas du gâteau !! En substance ça dit que lorsque l'on utilise le phénomène de réluctance variable pour induire une bobine, La force contre électromotrice est quasiment inexistante, L'alternateur est naturellement freiné par l'arrachement polaire et autre frottement, mais le fait d'extraire du courant ne créer pas plus de couple résistant. Il y est dit également que le générateur augmente se phénomène à certaines vitesses dite de résonances. Les poteaux les jambes etc. sont relative à la description de la forme du circuit magnétique. Quand au perforateur, c'est sur cette machine que les première observation du phénomène ont été faite. Il s'agissait d'une machine de chantier alimenté par un groupe électrogène, Ce dernier utilisait un alternateur à réluctance et un beau jour à fini par s'auto-alimenter. Je te la fait un peu courte et romancé mais c'est l'idée. Le brevet que j'ai mis au bout donne une bonne description du concept, Le rotor fait office de barreau de court circuit à des distances stratégiques du stator. C'est pour cette raison que j'ai posté après les remarques également pertinentes de Yatanagan. Par le passé j'ai déjà imaginer un système du même genre voir page perso, mais le brevet montre un autre aspect qui me semble bien meilleurs, à savoir on ne déplace pas d'aimant, mais juste du fer, Donc les chances de ne pas avoir de couple résistant du à la FCEM sont bien plus probable. A+++ -------------------- Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie.
Page YouTube, Page Dailymotion, Album Picasa, La Force contre-électromotrice, simulation magnétique, Viktor Schauberger |
|
Ecrit le: Dimanche 06 Décembre 2009 à 10h57

|
|||
 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 170 Membre n°: 9855 Inscrit le: 07/01/2009 |
Bonjour à tous, Merci beaucoup Quartz pour les liens et la traduction de Tagor. Hyper intéressant !!! Notamment le passage :
Je vais finaliser et mettre en ligne la vidéo de la manip. du fonctionnement en alternateur du Roto-Commutateur que j' ai réalisé durant ma campagne de mesures. A++ |
||
|
Ecrit le: Dimanche 06 Décembre 2009 à 11h12

|
|||
 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 170 Membre n°: 9855 Inscrit le: 07/01/2009 |
Quartz nos post ce sont croisé.
Nous allons faire des manip. en ce en sens dés que possible. A++ |
||
0 utilisateur(s) sur ce sujet (0 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres:
 Pages: (87) « Première ... 57 58 [59] 60 61 ... Dernière » Pages: (87) « Première ... 57 58 [59] 60 61 ... Dernière » |
   |
[ Script Execution time: 0.6016 ] [ 13 queries used ] [ GZIP activé ]




