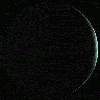
| chercheursduvrai.fr |
 Aide Aide
 Recherche Recherche
 Membres Membres
 Calendrier Calendrier
|
| Bienvenue invité ( Connexion (Log In) | Inscription (Register) ) | Recevoir à nouveau l'email de validation |

 To view this board in english, you must be registered.
To view this board in english, you must be registered.Excellent site trouvé, très fourni sur les contactés extraterrestres, à visiter : https://contactstellaire.fr
| Pages: (87) 1 [2] 3 4 ... Dernière » ( Aller vers premier message non lu ) |    |
Richard |
Ecrit le: Dimanche 16 Avril 2006 à 16h43

|
|
Unregistered |
Bonjour. Je suis très intéressé par l'énergie libre et je recherche des expériences simples pour comprendre le mécanisme et construire sa propore machine. Le but étant naturellement de créer plus d'électricité que ce que la machine en consomme. Merci de m'indiquer des liens ou de me transmettre des fichiers. A bientôt. richard_sgib@hotmail.com
|
|
|
|
Ecrit le: Mardi 18 Avril 2006 à 06h06

|
|
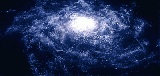 Administrateur       Groupe: Administrateurs Messages: 5756 Membre n°: 1 Inscrit le: 04/08/2002 |
Il faut lire le site et les liens sur l'énergie libre. Personne n'a de matériel clef en main à donner puisque des centaines de personnes clament avoir créé des machines à énergie libre et peu fonctionnent. Il faut chercher et essayer soi-même, et ça coûte cher, en temps, en énérgie et en monnaie trébuchante de construire une machine et la tester.... pour se rendre compte dans 95% des cas que ça ne marche pas et passer à la suivante. En 2 ou 3 essais la plupart des gens arrêtent parceque à moins d'être millionnaire c'est dur de continuer.
Ou alors il faut chercher et chercher et suivre son intuition plutôt qu'essayer au hasard, ça peut aider. N'empêche personne n'a de certitude malgré bien des proclamations de surunité. Alors demander un lien ou un fichier vers une machine qui marche c'est exactement comme demander un livre qui prouve que Dieu existe: c'est ignorer tout du domaine. Il vous reste à vous documenter. Bon courage car les documents il y en a et les décortiquer c'est un travail de forçat. -------------------- "L’homme sage n’est pas comme un vase ou un instrument qui n’a qu’un usage ; il est apte à tout."
"Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu." Confucius |
andy |
Ecrit le: Samedi 29 Avril 2006 à 08h22

|
|
Unregistered |
bonjour,
tout d'abord merci pour ce forum et votre facon symple d'aborder le sujet.... (cfr litérature très complexe et austère, quand on est pas dans le délire ovni-conspiration...) et d'en faire profiter tout le monde. j'ai aussi passé des heures a reproduire quelques expériences de Naudin (pantone qui marche terriblement bien en conidérant que c'est un bricolage grossier d'un amateur sans matos, plasma,...) , a me documenter sur tesla et toutes les expériences qui se raportent au MEG, mais dans le cas du MEG je ne suis jamais passé a l'expérimentation.... je ne peut donc pas vous aider beaucoup mais je pensais a un truc pour ce qui est de l'aimant permanent placé au centre du meg. pourquois ne pas le remplacer par un solenoide de facon a pouvoir faire varier son champ magnetique et le barreau sur lequel l'enroulement prend place pourais etre dimensionné plus facilement qu'un aimant permanent commandé sur mesure. |
|
|
LABO343, Climens Aimé. |
Ecrit le: Samedi 29 Avril 2006 à 16h14

|
|
Unregistered |
réponse à Andy. Le principe meme du MEG est de "soutirer" de l'énergie d'un aimant permanent. L'utilisation à sa place d'un solénoide en ferait un simple transformateur. En effet lorsque la permutation entre les deux branches du double circuit magnétique s'opère, la variation de flux dans les bobines de puissance y induit une tension qui elle meme induit un courant si une charge est placée dans leur circuit. Ce courant a pour effet de s'opposer au flux qui l'a créé. Le solénoide va donc etre soumis à un flux décroissant qui va provoquer un appel de courant, annulant le gain produit par la charge. Dans le cas de l'aimant permanent l'énergie provient d'ou elle veut sauf d'une consommation officiellement identifiée. A suivre..
Je profite de cette réponse pour évoquer une piste concernant le rendement du MEG : les pertes ohmiques. Concernant mon expérience avec une fréquence de permutation de 1 hertz je constate une perte ohmique de 50% sur les bobines de commande. En effet ces bobines ont une résistance de 3 ohms , ce qui limite le courant à 4 ampères en régime continu sous 12 volts. Lors du fonctionnement en permutation avec la charge de 20 watts sur les bobines de puissance le courant tombe à 2 ampères. Il s'agit donc de 2 ampères traversant une résistance de 3 ohms, soit 12 watts dissipés en chaleur pour rien. Sans évoquer l'emploi de bobines supraconductrices dont le prix exclut l'expérience privée, on peut fortement limiter la perte ohmique en permutant avec une fréquence plus élevée. En effet si la vitesse de variation des flux augmente, la tension induite dans les bobines de puissance augmentera aussi. On pourra donc utiliser des bobines comprenant moins de spires pour une meme tension de sortie. La conséquence sera évidente sur la résistance des bobines : moins longues et plus de section de fil pour un meme volume disponible = moins de résistance. Pour mon expérience je vais essayer de permuter à 50 hertz puisque le circuit magnétique de mon MEG était prévu pour. Pour comparaison voir les transfos d'aviation en 400 hertz ou les bobinages sont courts et massifs donc peu résistants. |
|
|
andy |
Ecrit le: Mardi 02 Mai 2006 à 18h35

|
|
Unregistered |
j'ai relu pas mal de notes et mes cours sur l'electrostatique et le magnétisme histoire d'y voire plus clair et de ne plus (enfin j'espere) dire de betises qui ne feraient pas avancer le shmilblik....d'ailleur merci a LABO343 pour tes explications
J'ai vraiment du mal a concevoir un systeme surunitaire, tellement drillé a avoir une égalité parfaite entre l'énergie injectée, celle dépensée par le systeme et l'energie de sortie... j'aimerais expérimenter a moindre cout le meg. Pour la partie electronique de commande ca ne me pose pas de probleme par contre pour le meg lui meme je me pose des questions concernant la taille de la carcasse et de sa composition (j'ai des carcasses de transfo hors d'usage), quid des alliages nanocrystalins (je pense que si le meg ne marche pas avec une bete carcasse de transfo, il ne fonctionera pas mieux avec ce genres d'alliages). je me pose aussi la question de la fréquence de fonctionnement (question qui va de pair avec la précedente --> technologies différentes selon la fréquence utilisée) si les expériences faites en basse fréquences n'ont pas étés fructueuses..... en résumé et puisqu'on ne peu pas se fier aux expériences deja réalisées pour dimensionner la machine (cfr solution clef en main voila, c'est beaucoups de questions... si on pouvais deja régler celle de la fréquence de fonctionnement. |
|
|
|
Ecrit le: Lundi 29 Mai 2006 à 15h12

|
|
|
Visiteur (e)  Groupe: Membres Messages: 1 Membre n°: 158 Inscrit le: 29/05/2006 |
Salut tout le monde
comme beaucoup j'suis attiré par les nouvelles technologies et ce qui pourrait aider notre planete à mieux nous supporter. jai lu les brevets sur le meg et de l'equivalent français de Galey et jai eu l'envis de me joindre aux experimentations. Jai quelque connaissance en electronique mais je ne sais point du tout où me founir un bon noyau en C ou U comme il le faudrait bien. Ou vous etes vous fournis, pour les moins chanceux? cest surtout la carcasse le plus embetant je pense, en vente pour les particuliers jen ai pas vu pour les aimants je penses passer par l'un ou l'autre de ces shops en ligne http://www.powermagnetshop.de http://www.neotexx.de salutation |
|
Ecrit le: Lundi 29 Mai 2006 à 17h38

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonjour. En réponse à Yuplayou au sujet de la carcasse magnétique du MEG je pense que la tole de transfo classique peut permettre de démarrer une expérience pour pas cher. En effet la permutation des voies magnétiques à très haute fréquence se heurte à l'inductance des bobines de commande. Meme avec 10 spires bobinées sur un circuit magnétique à haute perméabilité on ne pourra pas dépasser une fréquence de quelques milliers de hertz sans supprimer les ampères-tours nécessaires à la production du champ de commande. De plus la très haute fréquence génère des pertes par capacité répartie dans les bobines.
Ci joint une réflexion sur la fréquence de permutation des bobines de commande. Je pense que pour une masse magnétique de 20 à 30 kg on doit se situer dans un fonctionnement entre 50 hz et 400 hz. 7 MAI 2006. MEG : usage du courant rectangulaire à haute fréquence LABO 343 grâce aux bobines à faible inductance. Les bobines primaires ne donnent pas de résultat avec du courant sinusoïdal. La permutation Des champs magnétiques dans le MEG est efficace avec l’usage du courant continu « segmenté » ou « rectangulaire ». L’inductance propre des bobines primaires détermine le temps nécessaire au plein épanouissement des champs de contrôle du MEG ( la constante de temps ) . Ce temps déterminera la tension qui va apparaître aux bornes des bobines de puissance. Plus ce temps est bref et plus la tension de sortie sera élevée, donc plus sera grande la puissance du MEG car L’intensité de sortie est liée aux ampères-tours du circuit secondaire, non liés à la fréquence. Si l’on veut « forcer » les bobines primaires à permuter au delà de leur « fréquence propre » On perdra l’usage d’une partie du champ de contrôle du MEG d’autant plus que l’on utilisera Une fréquence plus élevée que celle voulue par les bobines elles même. Les bobines primaires ont une résistance ohmique qui cause une perte d’énergie. Pour contrecarrer les pertes ohmiques il faut que la réactance d’inductance soit largement Supérieure à la résistance ohmique. Pour y arriver il faut diminuer le nombre de spires de Chaque bobine primaire pour diminuer son inductance propre et augmenter de ce fait la Vitesse de variation du flux produit par la bobine et donc rendre possible la permutation Plus rapide des bobines primaire en gardant le plein usage des champs de contrôle du MEG. La permutation plus rapide augmente donc la réactance d’inductance liée à la fréquence Par la formule sinusoïdale comparable : R = oméga x L , dans laquelle oméga = 2 x pi x f. Ainsi pour un même encombrement géométrique des bobines de commande, nécessaire à leur action, on pourra utiliser moins de fil plus gros et donc moins résistant. Les bobines secondaires ou de puissance doivent avoir une inductance égale aux bobines de Commande. En effet le passage d’un courant dans les bobines secondaires va créer un champ Qui va s’opposer aux causes qui l’ont lui même créé. Ce champ se développera en un certain temps en fonction de l’inductance de la bobine secondaire. Si le champ secondaire met trop de temps à se développer par rapport au champ primaire on ne pourra récupérer qu’une partie De l’énergie : celle produite par le temps de la variation du flux primaire. Une piste à suivre: l'effet "A B" alias "aharonov-bohm". à plus |
|
Ecrit le: Vendredi 02 Juin 2006 à 22h35

|
|
|
Visiteur (e)  Groupe: Membres Messages: 1 Membre n°: 160 Inscrit le: 02/06/2006 |
En réponse à Yuplayou, tu peux commander des carcasses à la société:
ISOLECTRA- MARTIN impasse du moulin 80700 ROYE Tel: 03 22 87 66 00 Ils ont un bon catalogue avec les caractéristiques , mais c'est pas donné. Pour une carcasse de MEG type JL Naudin , je l'ai payée une centaine d'euros, mais la matière première ayant augmenté dans des proportions incroyables je crois qu'il faut maintenant compter le double. En ce qui concerne l'aimant je l'ai commandé sur mesure à la société Toutaimant, aux 4 routes 47150 SALLES Tel: 05 53 71 20 59 Sur un autre sujet, j'aimerais avoir votre avis sur une offre d'une société américaine qui propose un générateur de 30 kW à énergie libre. Pour les bons en anglais, il y a une vidéo téléchargeable décrivant le principe de fonctionnement: magnétisme et gravité. Pour ma part je suis sceptique. De toute façon l'offre est réservée aux USA ET Canada. SITES: www.freelectricity.com www.innovativetech.net/electricity.htm |
|
Ecrit le: Lundi 05 Juin 2006 à 16h08

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
MEG LABO343 4 JUIN 2006.
Commutation des bobines de commande : 3 problèmes dont un de très important. Dans le cas de la commutation mécanique. 1° : la pression sur les contacts nécessaire pour la circulation immédiate du courant. J’ai fait un essai de commutation circulaire avec un collecteur de dynamo et un « balai » En cuivre graphité. On a une forte perte de puissance de sortie due à une résistance de Passage du courant entre le balai et le collecteur. La solution est d’utiliser un contact Identique aux « vis platinées », ce qui présente l’avantage de limiter l’inertie des masses De contact en mouvement. 2° :la nature métallique des contacts. L’action du contact crée un mini arc électrique qui dépose sur la surface des contacts de l’oxyde qui crée une résistance au passage du courant. Il faut donc un métal très conducteur, inoxydable et à haute température de fusion : toujours Les vis platinées. 3° : le plus important c’est l’extra courant de rupture. Ce courant est du à la tension créée par la décroissance du champ magnétique des bobines de commande et profitant du champ électrique très élevé à l’instant de la séparation des contacts. Ce champ électrique ionise l’air et fait circuler un courant jusqu’au point de séparation critique des électrodes. Pour limiter les effets destructifs de ce courant sur les contacts on peut enfermer le commutateur dans une enceinte hermétique soumise à une pression d’air élevée pour Diminuer le seuil de séparation critique des électrodes. L’extra courant de rupture c’est aussi la restitution de l’énergie non ohmique consommée Par les bobines de commande en dehors de toute charge sur les bobines secondaires. Dans les inductances traversées par un courant sinusoïdal il n’y a pas de consommation d’énergie autre que par les pertes ohmiques ou les pertes dans le fer. Tout ceci m’amène à une réflexion : le courant consommé par le MEG dans les bobines de commande est dissipé en chaleur par pertes ohmiques et en rayonnement par l’arc de l’extra Courant de rupture. Dans mon montage le fait d’enlever ou de mettre la charge sur les bobines De puissance ne change pratiquement pas la consommation des bobines de commande. J’ai mesuré une différence d’environ 0,3 ampères sous 12 volts pour une production de la charge de 1 ampère sous 7 volts. Tout ceci à une fréquence de commutation d’environ 1 Hz. Le « système » MEG produit donc plus d’énergie qu’il en consomme mais le bouclage de L’énergie impose l’identité de la forme de l’énergie. Il faut donc diminuer les pertes ohmiques et « aspirer » l’énergie perdue dans le courant de rupture. A suivre. |
|
Ecrit le: Lundi 12 Juin 2006 à 16h56

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
MEG LABO343 : 11 juin 2006.
D’OU VIENT L’ENERGIE GRATUITE ? Au départ je constate que la puissance produite par la charge est supérieure à la consommation qui la concerne. Le reste de la consommation étant du à des pertes Ohmiques et à l’extra courant de rupture dans le circuit des bobines de commande. Donc je vais suivre le chemin du courant de charge et de ses conséquences. Le courant de Charge crée un flux qui s’oppose à ce qui l’a créé. Ce flux contraire a le choix de circuler Par le chemin extérieur qui passe par la bobine de commande ou bien par le chemin central Qui passe par l’aimant permanent. La partie de ce flux qui passe par la bobine de commande crée un « effet transfo » et provoque Une consommation de la bobine de commande. Or j’ai constaté que cette consommation était Egale (en puissance) à la moitié de la production de la charge. Cela implique que la puissance manquante est issue du chemin central passant par l’aimant permanent Cela implique aussi que la bobine de commande se comporte comme une « espèce de réluctance » « égale » à la réluctance du circuit passant par l’aimant permanent. Le flux contraire circulant à travers le chemin de l’aimant permanent se comporte comme un champ démagnétisant faible ( à cause de la réluctance du circuit ) et ne met pas en danger le type d’aimant fer bore néodyme. En fait le MEG semble être un système permettant de « coller une charge » sur un Aimant permanent en créant une situation de « chemin de flux nouveaux de façon permanente Avec une charge qui suit l’errance de ces flux ». L’aimant permanent serait donc la « porte De l’énergie » depuis …ce qu’on veut. |
|
Visiteur (e)  Groupe: Membres Messages: 2 Membre n°: 163 Inscrit le: 12/06/2006 |
Bonjour c'est avec intêret que je viens de lire le compte rendu des experiences sur le Meg ainsi que certains documents relatif au brevets j'ai été supris de l'approche totalement empirique du sujet ! je m'explique : En parcourant le web pour avoir des info je n'ai trouvé null note concernant l'aspect Theorique du procédé . Quand j'entend theorique , je parle évidement de Calcul Théorique : Calcul théorique au niveau electrodynamique exemple de calcul fourni par leisa dans ces modelisations : Electrodynamique de planete Ai-je loupé des doc sur le web ? Le MEG : Théorie
or si je m trompe pas l'entrefer d'un transformateur est fait de fer et non de vide (ayant comme propriété une faible reluctance ) peut-on transposé cette théorie dans un autres matèriaux sans aucun calcul ?
Autres points : d'après les souvenir des cours d'electrostatique/Electrotechnique /electronique qui me reste en mémoire (ca date de 1991 tout de même, le champ magnetique de l'entrefer me semble pas sortir de celui ci , donc l'effet d'un autre champ perpendiculaire n'a certainement aucun effet (sous reserve de verification ) ... 83% de rendement avec signaux non dephasé c'est quand même un rendement correct pour un tranfo calcul et modèlisation des shèma électroniques absent des brevets Il me parait pourtant essentiel de modeliser les circuits (equation laplace et tout le toutime ...) pour savoir quelle sont les signaux attendu et faire un comparatif avec les mesures . loin de moi de dénigrer le travail des experimentateurs j'espere que ces quelques remarques pourrons les faire progresser dans leur travail en ce qui me concerne je rejoindre l'avis de certain, les co-inventeur du procedé sont soit au mieux des fumistes , au pire des escros |
||
|
Ecrit le: Lundi 12 Juin 2006 à 18h15

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 : Réponse à Moonstars
Je suis aussi frustré que vous. Lorsque j’ai découvert le MEG sur le web j’ai cherché partout Les plans précis de fabrication. Impossible. Le seul plan disponible étant celui de Bearden ou Naudin. Mais ces plans ne fonctionnent pas. Seule l’idée de départ du double circuit magnétique avec aimant permanent en commun est un bon moyen de tester cette invention. Quant à la théorie elle est trop « loin » et il manque le chaînon permettant de coller au réel. Alors je me suis dit qu’il fallait faire un test en réel. Je ne me suis pas arrêté à la nature du circuit magnétique car je me doutais que les fréquences présentées étaient inexploitables vu Les inductances probables des bobines de commande. J’ai pensé que « ça devait marcher » en basse fréquence type 50hz. Au niveau des entrefers, pas de problème : il n’y en a pas. On a affaire à un circuit double fermé dont la réluctance est fonction de la section , de la longueur des circuits et de la qualité Des tôles magnétiques. La seule réluctance néfaste c’est celle de l’aimant permanent pour le passage d’un champ contraire et elle est « assimilable » à un entrefer car la perméabilité de ces aimants permanents est quasi nulle. Pour le reste il faut ouvrir les yeux et essayer de pénétrer la matière. J’ai obtenu facilement Des résultats très troublants à 1 hz ! Tout ce que je vois, je l’écris et je l’envoie sur le forum. Je reste « collé » aux données du magnétisme reconnues : il ne faut surtout pas se perdre. L’expérience n’est pas chère. Il m’a fallu 14 euros pour 1 aimant permanent, 20 euros pour du fil de bobinage ( pour la bobine de commande) et 15 euros pour récupérer un transfo triphasé A la ferraille. Le reste c’est beaucoup de patience. Ce serait bien que beaucoup de monde « remue » dans ce système . |
|
Ecrit le: Mardi 13 Juin 2006 à 22h46

|
|
|
Visiteur (e)  Groupe: Membres Messages: 1 Membre n°: 164 Inscrit le: 13/06/2006 |
Ci dessous, un lien qui amène sur le site de JP Petit
http://www.jp-petit.com/Disclosure/bearden.htm visiblement le MEG n'est pas tout à fait au point !!! Par contre, il y a beaucoup de choses interessantes à lire sur ce site. |
|
Ecrit le: Mardi 13 Juin 2006 à 23h40

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 : je suis allé sur le site que vous indiquez. Je l’avais déjà visité quand je cherchais
A récolter toutes les infos pour et contre le MEG. L’impression qui m’en reste c’est qu’on n’avance pas. La réfutation des explications de Bearden concernant l’origine de l’énergie « issue » du MEG ne s’accompagne pas d’une démonstration concernant l’appareil lui même. Cela semble relever plutôt de l’idéologie. Ce qui m’intéresserait ce serait une réflexion alternative sur les paramètres matériels de cet appareil : les bobines de commande par exemple ou bien le passage d’un flux inverse dans un aimant permanent et sa quantification. Pourquoi cette capacité observée des bobines plates alimentées en courant continu de Jouer un rôle d’ « aspirateur » ou de « repoussoir » de flux dans le MEG ? |
|
Ecrit le: Samedi 17 Juin 2006 à 22h26

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
17 JUIN 2006.
LABO343 MEG EXTRA COURANT DE RUPTURE LE MULTIPLICATEUR D’INTENSITE Dans le MEG les deux bobines de commande sont identiques et se font face dans le circuit Magnétique. Leur action est opérante quand leurs pôles identiques se font face alternativement avec le pole identique de l’aimant permanent. Si l’on considère que ces bobines ont des enroulements identiques, il y aura dans chacun une extrémité au centre de celui ci (contre le noyau en fer) et une autre à la périphérie. Nommons la bobine gauche B1 et la bobine droite B2. Le fil du centre de B1 sera connecté sur une borne « choix » d’un inverseur et le fil de la Périphérie de B2 sera connecté sur l’autre borne « choix » de cet inverseur. Le « commun » De cet inverseur sera connecté (par exemple) sur le + de la batterie. De la même façon le fil de la périphérie de B1 sera connecté sur une borne « choix » D’un deuxième inverseur et le fil du centre de B2 sera connecté sur l’autre borne « choix » De ce deuxième inverseur. Le « commun » de ce deuxième inverseur sera connecté (donc) sur le – de la batterie. Ces deux inverseurs agiront ensemble de façon à ce que les deux fils de la bobine B1 soient Connectés lorsque les deux fils de la bobine B2 seront déconnectés. La récupération de l’énergie produite par la décroissance des champs magnétiques des bobines de commande se fera en utilisant deux connections traversant chacune une diode. Ainsi il y aura une connexion entre le centre de B1 et le centre de B2 à travers une diode Dont le sens de montage s’opposera au fonctionnement en parallèle des bobines B1 et B2. De la même façon il y aura une connexion entre la périphérie de B1 et la périphérie de B2 A travers une diode dont le sens de montage s’opposera aussi au fonctionnement en parallèle Des bobines B1 et B2. Lorsque la bobine B1 sera déconnectée, la décroissance de son champ magnétique fera naître un courant qui pourra se déverser dans la bobine B2 à travers le chemin des diodes et idem pour la déconnexion de B2. Le plan ci dessus expliquant comment récupérer l’extra courant de rupture semble Définir un multiplicateur d’intensité . Lors de la première expérience de son branchement, l’intensité du courant passant par Les bobines de commande est passé de 2 ampères à 10 ampères, soit plus que la somme Des deux intensités des bobines en parallèle et sans mouvement de croissance des flux. La charge elle aussi a augmenté sa puissance, preuve qu’il ne s’agissait pas d’un court circuit Dans les diodes ou dans les bobines de commande. Il suffirait donc d’alimenter ce montage sous une tension initiale inférieure pour retrouver Les ampère tours nécessaires à la charge de référence : c’est ainsi l’expression d’une augmentation du rendement du MEG. Ainsi ce système provoquerait l’addition des intensités Récupérées et injectées à chaque cycle. |
|
Ecrit le: Dimanche 18 Juin 2006 à 16h07

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 18 JUIN 2006
Je viens de déceler un problème dans mon inverseur de bobines de commande. L'expérience précédente doit donc etre mise sous réserve. La traque de l'extra courant de rupture continue toujours... |
|
Ecrit le: Mardi 20 Juin 2006 à 16h05

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Après avoir constaté un défaut de fonctionnement de mon système de commutation, j'ai repris l'idée de récupération de l'extra courant de rupture et voila ce que je trouve.
21 JUIN 2006. LABO343 MEG EXTRA COURANT DE RUPTURE Dans le MEG les deux bobines de commande sont identiques et se font face dans le circuit Magnétique. Leur action est opérante quand leurs pôles identiques se font face alternativement avec le pole identique de l’aimant permanent. Si l’on considère que ces bobines ont des enroulements identiques, il y aura dans chacun une extrémité au centre de celui ci (contre le noyau en fer) et une autre à la périphérie. Nommons la bobine gauche B1 et la bobine droite B2. Le fil du centre de B1 sera connecté sur une borne « choix » d’un inverseur et le fil de la Périphérie de B2 sera connecté sur l’autre borne « choix » de cet inverseur. Le « commun » De cet inverseur sera connecté (par exemple) sur le + de la batterie. De la même façon le fil de la périphérie de B1 sera connecté sur une borne « choix » D’un deuxième inverseur et le fil du centre de B2 sera connecté sur l’autre borne « choix » De ce deuxième inverseur. Le « commun » de ce deuxième inverseur sera connecté (donc) sur le – de la batterie. Ces deux inverseurs agiront ensemble de façon à ce que les deux fils de la bobine B1 soient Connectés lorsque les deux fils de la bobine B2 seront déconnectés. La récupération de l’énergie produite par la décroissance des champs magnétiques des bobines de commande se fera en utilisant deux connections traversant chacune une diode. Ainsi il y aura une connexion entre le centre de B1 et le centre de B2 à travers une diode Dont le sens de montage s’opposera au fonctionnement en parallèle des bobines B1 et B2. De la même façon il y aura une connexion entre la périphérie de B1 et la périphérie de B2 A travers une diode dont le sens de montage s’opposera aussi au fonctionnement en parallèle Des bobines B1 et B2. Lorsque le courant alimentant la bobine B1 est coupé, le champ créé par cette bobine décroît Et de ce fait crée une tension dans la bobine qui s’oppose à cette décroissance. Si la décroissance est uniforme, la tension créée le sera aussi et si cette tension peut se déverser Dans une charge il y aura création d’un courant constant jusqu’à la disparition totale du champ et donc cessation de la décroissance. Dans le cas du schéma expliqué ci dessus la bobine B1 va se comporter comme un générateur dont B2 sera la charge. Cette charge étant une inductance résistante, le courant issu de B1 va créer un autre champ magnétique. Lorsque le courant issu de B1 cessera, le champ de B2 décroîtra , créant à son tour une tension qui se Déversera dans B1 , etc… Cependant il y aura des pertes ohmiques, des pertes dans les diodes et une « perte » due à La consommation propre du MEG. Il y aura donc amortissement du courant récupéré. Le rôle de la commutation sera de ramener l’énergie manquante. La quantité de courant circulant D’une bobine à l’autre sera l’indice du rendement de la récupération du courant de décroissance des champs magnétiques des bobines de commande. Il sera important de connaître la durée de chaque cycle, définie par la constante de temps des bobines. La commutation devra être en phase avec la durée de récupération du courant. La consommation extérieure pendant la commutation sera égale à la différence entre le courant issu de la récupération et le courant issu de l’extérieur au premier cycle. à suivre... |
|
Ecrit le: Dimanche 25 Juin 2006 à 17h44

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
DIMANCHE 25 JUIN 2006.
MEG EXTRA COURANT DE RUPTURE EXPERIENCE DE RECUPERATION DE L’ENERGIE. 23 JUIN. En débranchant une des bobines de commande je me demandais si le courant de récupération augmenterait car il ne serait pas « écrasé » par le courant d’alimentation. Et bien non. Dans ce cas le courant de récupération est divisé par deux et la charge sur les bobines de puissance aussi. Constaté au voltmètre, le courant de récupération est bien de même sens que le courant d’alimentation des bobines de commande. Ce n’est pas le courant d’alimentation qui gène le courant de récupération. Donc le courant de récupération est au départ issu d’une tension due à la décroissance du champ d’une bobine. Cette tension est identique à celle qui s’oppose au courant extérieur pendant la croissance du champ de la bobine, soit ici 6 volts. Donc ces 6 volts de la tension initiale de récupération traverseront les deux résistances ohmiques des bobines soit 6 ohms. De plus il y aura 1 volt de perdu (environ) dans chaque diode. Le courant maxi récupérable serait donc de 0,66 ampère. Or le courant constaté est de 0,15 ampère. Ou passe l’énergie manquante ? 24 JUIN Elle passe encore dans l’étincelle de rupture car l’arc de cette étincelle a une très faible résistance. Pour comparaison, dans la soudure à l’arc, pour une électrode de diamètre de 2,5 mm, on a une tension d’amorçage de 50 volts sous un courant d’environ 100 ampères, une tension aux bornes de l’arc de 25 volts et un arc d’environ 3 mm de long. Cela nous donne une résistance d’arc de 0,25 ohms soit 0,08 ohms par mm d’arc. Tout ceci pour dire que dans les contacts mécaniques le courant de rupture est partagé au pro rata de la résistance des chemins. Ceci est donc une limite à l’usage de ces contacts. 25 JUIN Si l’on enlève la charge le courant de rupture récupéré passe de 0,15 à 0,30 ampère. Preuve que l’absence de charge ne vient plus s’opposer au champ créé par la bobine de commande. Avec un inverseur différent dont une borne « choix » fait contact par ressort de rappel, la charge n’atteint que 6 volts au lieu de 7 avec les relais à contact magnétiques : preuve que dans les contacts mécaniques la pression est un paramètre majeur du rendement. Encore une limite pour les contacts mécaniques. Avec ce nouvel inverseur on a une vision directe sur les contacts et on constate que le circuit de récupération à diodes laisse subsister des étincelles au contacts, confirmation de l’existence De l’énergie perdue, vraisemblablement transformée en rayonnements. Néanmoins le circuit de récupération fait baisser la tension aux bornes des contacts à l’ouverture. L’intensité absorbée sur le circuit d’alimentation baisse de 2 volts à 1,9 volts lorsqu’on a connecté le circuit de récupération tandis que la tension de la charge est indifférente à la connexion du circuit de récupération. Ceci voulant dire que le circuit de récupération augmente le rendement et que la tension de la charge dépend uniquement des ampères tours Sur les bobines de commande pour une configuration magnétique donnée. La baisse de la résistance ohmique des bobines augmentera aussi le rendement de la récupération. A suivre.. |
|
Ecrit le: Vendredi 30 Juin 2006 à 15h43

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 30 juin 2006. Une erreur de frappe sur le texte précédent : "l'intensité absorbée sur le circuit d'alimentation baisse de 2 AMPERES à 1,9 AMPERES" et non "de 2 volts à 1,9 volts. Mes excuses pour cette inattention.
|
|
Ecrit le: Mardi 04 Juillet 2006 à 10h14

|
|
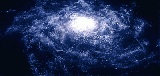 Administrateur       Groupe: Administrateurs Messages: 5756 Membre n°: 1 Inscrit le: 04/08/2002 |
Zoonos,
Bearden passe son temps à nous faire poireauter, annonçant que ça marche mais que pour des raisons économiques il ne peut produire le MEG en quantité. Déjà si il laissait une équipe indépendante vérifier la véracité du fonctionnement du MEG... mais non bien sûr! Moonstar, Oui, il n'y a pas d'analyse des signaux très précise sur les seules sources à disposition... Naudin et Bearden. D'où mes mesures de signaux, et je ne suis pas le seul (à ce propos un italien que j'ai invité à venir ici mais qui ne l'a pas encore fait a les mêmes que moi, lui aussi a travaillé sur une réplique du Meg de Naudin). Nos signaux montrent déjà qu'on n'a pas ce qu'on voudrait... et que Naudin ne peut pas avoir ce qu'il annonce... mais rien d'autre malheureusement. -------------------- "L’homme sage n’est pas comme un vase ou un instrument qui n’a qu’un usage ; il est apte à tout."
"Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu." Confucius |
|
Ecrit le: Mardi 04 Juillet 2006 à 15h44

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343
MEG 4 JUILLET 2006. Au sujet de la production du MEG en série. Je pense que l’espoir de « faire fortune » avec la production en série du MEG est une Illusion. Le seul « profit » que l’on peut espérer de ce genre d’appareil est celui de se tirer D’un piège menaçant : le pic pétrolier. On ne peut plus raisonner en terme individuel face à Cette menace. La seule solution qui « avance » est de publier TOUT ce que l’on sait pour que Le « cerveau commun » des bipèdes à station verticale « ponde » une solution. A quoi servira De garder un secret si le pic Hubbert emporte notre société au moyen age ? Je ne comprends pas l’attitude de Bearden pour cela. Il est clair qu’il devrait publier tout ce qu’il sait. Ce qui me fait peur c’est le mouvement de panique qui éclatera le jour ou les statistiques de production pétrolière dévoileront le début de la déplétion. Si l’énergie de remplacement n’est pas prête rien n’arrêtera le chaos. Dans cette optique celui qui sait et ne dit rien… |
|
Ecrit le: Lundi 10 Juillet 2006 à 17h35

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
10 JUILLET 2006.
LABO343 MEG D’où vient l’action des bobines de commande. Dans une expérience précédente j’avais constaté que la bobine « plate » « réorientait » nettement plus le flux de l’aimant permanent que la bobine « longue »(solénoïde). Lorsque ces deux types de bobines sont parcourues par un courant il y a création d’un champ d’excitation magnétique « H ». Pour un même champ d’excitation dans le vide (sans circuit magnétique ferreux) l’induction au centre de ces bobines est très différente. Elle est beaucoup plus faible dans la bobine longue pour une section centrale identique que dans la bobine plate. Quand je dis même champ d’excitation cela veut dire autant de spires et le même courant de passage. Par exemple une bobine plate de 1 cm d’épaisseur avec 200 spires parcourues par 2 ampères aura le même champ d’excitation qu’une bobine de 30 cm de long avec 200 spires parcourues par 2 ampères. La bobine de 30 cm de long n’aura pratiquement aucun effet de « réorientation » du flux de l’aimant permanent dans le MEG. Cette réorientation semble provenir de l’induction magnétique ( B) spécifique à chaque type de bobine et donc favorisée dans la bobine plate ( à champ d’excitation égal). En tout cas elle en est fonction directe. Alors que se passe t’il lorsqu’on insère un circuit magnétique ferreux (et fermé) au travers de ces bobines ? L’observation semble indiquer que la bobine plate conserve une action « locale » sur le circuit magnétique qui la traverse. Mais plate jusqu’ou ? L’épaisseur d’une feuille de papier ? Ou plus large… La différence est très importante car le rendement du MEG En dépend. Si il suffit d’un fil de 1mm d’épaisseur bobiné à plat au lieu d’une bobine de 1cm D’épaisseur pour obtenir la même action de « réorientation » magnétique, alors il faudra 10 Fois moins de champ d’excitation ( soit 10 fois moins d’énergie consommée) pour produire la même énergie due spécifiquement à la réorientation du flux de l’aimant permanent dans le MEG. |
|
Ecrit le: Samedi 22 Juillet 2006 à 17h05

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
FORME DES BOBINES DE COMMANDE
MEG LABO343 21 JUILLET 2006. Quel est le paramètre des bobines de commande qui permet de « rediriger » le flux de l’aimant permanent ? Est ce une densité ponctuelle de la force magnétomotrice du bobinage ? Ou bien est ce un volume soumis à cette même densité ? Dans le premier cas il suffirait d’une bobine plate ramenée à sa simple expression de surface, Ce qui limiterait la puissance mise en jeu (intéressant même si l’énergie est récupérée par les circuits à diodes). La diminution du nombre de spires de la bobine de commande agit sur la vitesse possible de commutation et le diamètre extérieur de la bobine de commande agit sur le rendement : plus il est grand et plus il y a de pertes ohmiques. Si l’on maîtrise l’évacuation des calories dans la bobine on a donc intérêt a réaliser une bobine dont le diamètre extérieur est proche du diamètre intérieur (et donc très proche du circuit ferreux). La spire ayant le meilleur rendement étant celle qui « colle » au circuit ferreux. Les spires plus éloignées entourent aussi le circuit magnétique ferreux mais elles entourent en plus une surface d’air dont la perméabilité est nulle. Un fil parcouru par un courant crée un champ magnétique circulaire autour de celui ci. Si ce fil est organisé en bobine plate et si le centre de cette bobine est traversé par un circuit magnétique ferreux dont la perméabilité est très supérieure à celle de l’air, Les lignes de force (créées par la bobine) dont la direction est parallèle au circuit ferreux (et qui passent par le point de concentration du centre de la bobine) sont extrêmement valorisées par rapport aux autres. La zone définie par le centre de la bobine plate parcourue par le circuit ferreux est donc Un lieu soumis à une « action » magnétisante. L’action de « redirection » du flux de l’aimant Permanent ne peut pas venir de la seule induction magnétique ( exprimée en tesla) puisque cette induction est constante dans tout le circuit magnétique si la section de celui ci est constante. L’induction est une « conséquence » de la force magnétomotrice de la bobine. La « redirection » du flux de l’aimant permanent n’est pas due à la saturation magnétique comme je le pensais au début (bien que ce qui la crée fait penser à la réluctance causée par la saturation). En effet cette action de « redirection » est à double sens : « refouloir » Dans un sens du courant de la bobine et « aspirateur » dans l’autre sens du courant (contrairement à la saturation qui est à sens unique : frein du flux). Ce qui Est observé cependant c’est la relation linéaire de l’intensité de la « redirection » avec l’intensité du courant dans les bobines de commandes. La zone géométrique du circuit magnétique soumise à l’influence du bobinage de commande Peut être comparée à la zone de ce même circuit soumise à l’action de la matière de L’aimant permanent. La forme assez stable du courant produit dans les bobines de puissance Amène à penser que la « redirection » du flux de l ‘aimant permanent varie par la comparaison de l’intensité des champs magnétisants dans ces « zones géométriques ». |
|
Ecrit le: Dimanche 30 Juillet 2006 à 17h20

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
MEG LABO343
24 JUILLET 2006. GROUPEMENT DES AIMANTS ET CONSOMMATION A VIDE DES BOBINES DE COMMANDE. Le premier montage de mon MEG comprenait 1 aimant permanent. La consommation Des bobines de commande était de 1 ampère à vide et de 2 ampères en charge (ampoule De 12 volts 20 watts). Le montage actuel comprend 4 aimants permanents positionnés en « parallèle ». La consommation des bobines de commande est de 1,8 ampères à vide et 2,1 ampères En charge (ampoule 12 volts 20 watts). Dans les bobines de commande utilisées selon leur stricte constante de temps (c’est à dire pendant le seul temps d’établissement ou de disparition de leur champ magnétique) il y a : avec 1 aimant , à vide, un courant de 1 ampère pendant la phase d’apparition « du flux de redirection ». La comparaison avec les 4 ampères passant en « régime continu » indique donc une résistance supplémentaire au courant. La résistance en « régime continu » est de 3 ohms, l’impédance pendant l’apparition du flux est de 12 ohms. Sur ces 12 ohms 3 sont toujours dus à la résistance ohmique et donc 11,6 ohms sont dus à la réactance d’inductance (pour une fréquence de 1 hertz) . avec 4 aimants positionnés en parallèle il y a un courant à vide de 1,8 ampères pendant la phase d’apparition « du flux de redirection ». L’impédance des bobines est donc de 6,66 ohms. Il y a toujours les 3 ohms de la résistance ohmique et donc seulement 5,94 ohms de réactance d’inductance (toujours pour une fréquence de 1 hertz). Cela est du au fait que le flux créé par la bobine de commande s’ajoute au flux des 4 aimants permanents dont le groupement rapproche le circuit magnétique de la saturation. Donc une même force magnétomotrice crée un flux plus faible. En charge avec 4 aimants la puissance produite est un peu plus forte malgré le fait que la bobine de commande produise moins de densité de « flux de redirection » pour une presque même consommation de 2,1 ampères. Cela veut dire que la proportion du flux (créé par le courant circulant dans la bobine de puissance) passant par l’aimant permanent plutôt que par Les bobines de commande est plus grande grâce à la moindre réluctance due au groupement des 4 aimants en parallèle. La « consommation spécifique » d’une même charge par « effet transfo »( définie par la différence entre la consommation à vide et en charge) passe de 1 ampère à 0,3 ampère entre 1 et 4 aimants permanents ce qui veut dire que pour 1 ampère effectivement consommée pour produire la charge avec 1 aimant il ne faut plus que 0,3 ampères pour produire effectivement la même charge avec 4 aimants. Dans le cas des 4 aimants la proportion de l’énergie qui est perdue en chaleur dans les bobines de commande est supérieure à cause de la baisse de la réactance d’inductance par rapport à la résistance ohmique des bobines. Mais comme la partie « effet transfo » de la charge diminue, il y a consommation globale presque similaire. La partie de l’énergie absorbée définissant la réactance d’inductance est récupérable par le « circuit des diodes ». La partie de la consommation due à la résistance ohmique des bobines est limitable par la commutation en fréquence plus élevée grâce aux bobines à peu de spires moins résistantes. L’énergie emmagasinée dans l’inductance d’une bobine de commande est ½ L I2 . Donc pour une bobine de puissance identique, avec 1 aimant permanent, on avait plus « d’effet transfo » qui augmentait l’absorption d’énergie retrouvée par transfert dans la charge. Il y avait aussi moins de perte par saturation du circuit magnétique, ce qui augmentait la proportion de l’absorption d’énergie récupérable par le circuit à diodes en augmentant la réactance d’inductance des bobines de commande. La résistance ohmique des bobines de commande étant identique. Avec 4 aimants permanents en parallèle il y a moins « d’effet transfo », ce qui diminue L’absorption d’énergie transférée à la charge (tout en matérialisant plus d’énergie en provenance « d’ou on veut ») mais il y a plus de perte d’efficacité de la commande à cause de la saturation du circuit magnétique qui diminue la densité du « flux de redirection » pour un même champ magnétisant. Cela signifie bien qu’il vaut mieux grouper les aimants permanents en parallèle mais en faisant en sorte de ne pas trop « monter au delà de la courbe de saturation » du circuit magnétique. On y arrivera en utilisant des aimants permanents individuellement de moindre champ magnétisant. Je conseille à ceux qui seraient interesses par un montage d'utiliser des diodes schottky et pour la commutation sur les bobines de commande des relais statiques. J'ai trouvé une référence fabricant pour 10 ampères : CMX60D10-MS11 chez CRYDOM. Après il faut trouver le générateur de fréquence de 1 à 50 hz et le système d'inverseur. Mon budget étant très proche de zéro, je ne sais pas quand je pourrai continuer à participer par l'expérience matérielle. |
|
Ecrit le: Vendredi 04 Août 2006 à 17h59

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO 343 MEG
5 AOUT 2006. Premier test avec les relais statiques. Utilisation de 4 relais dont les références sont décrites Précédemment. Le résultat le plus marqué est la forte augmentation du courant de récupération à la coupure des bobines de commande par un circuit à diodes. Auparavant le courant récupéré était de 0,15 ampères et il est de 0,6 ampères avec les relais statiques. C’est La preuve que l’étincelle des relais électromécaniques absorbait une partie de l’énergie consommée dans le circuit des bobines de commande. Dans ce premier test, le circuit de commande des relais statiques est commandé à la main à travers un « va et vient ». Le problème qui reste posé est le décalage temporel entre le courant de récupération et le courant Initial des bobines de commande. En effet l’action des diodes du circuit de récupération est très rapide mais la main l’est bien moins. Donc l’action de commande des relais statiques Doit elle aussi devenir très rapide en utilisant un inverseur électronique avec commande de la fréquence d’inversion entre 1 et 50 hertz. Un concept en passant au sujet du « pétrole abiotique ». On prétend que grace à ce pétrole il n’y aurait pas de pic de production, soit un débit conservé indéfiniment de 85 millions de barils par jour. Si ce débit était conservé dans le futur, il n’y a pas de raison qu’il n’ait pas existé dans le passé, voire depuis le début estimé de notre planète : 4,5 milliards d’années. Si l’on prend pour épaisseur de la lithosphère la valeur de 50 km on obtiendrait un volume De pétrole « produit » égal à 2,33 fois le volume de cette lithosphère. Mais ou est il donc passé ? |
|
Ecrit le: Vendredi 18 Août 2006 à 23h57

|
|
|
Visiteur (e)  Groupe: Membres Messages: 2 Membre n°: 174 Inscrit le: 18/08/2006 |
... ca ne va peut etre pas vous plaire ....principalement parce que c est cher
mais je pense que l or peut resoudre votre probleme. DP |
|
Ecrit le: Jeudi 07 Septembre 2006 à 22h01

|
|
|
Visiteur (e)  Groupe: Membres Messages: 2 Membre n°: 176 Inscrit le: 07/09/2006 |
je crois qu'il ne faut pas chercher trop loin ce qu'on a sous les yeux. La chaleur ambiante est utilisable avec des machines autonomes. Si vous avez fait de la thermo essayez donc de donnez un sens au postulat de Clausuis qui pour calculer le cop d’une pompe à chaleur, prend la formule de Carnot et la retourne, et hop !
La formule de Carnot 1-tf/tc est donnée pour des sources constantes. Une pompe à chaleur entre deux sources constantes n’a aucun sens. De plus le rendement d’une conversion travail-chaleur est toujours de 100%. Ce que Carnot appelle les irréversibilités vont dans le sens de la conversion lors d’une transformation travail-chaleur.. A ma connaissance ,la définition de COP est : COP=( Qfr+w)/w = sigma+1 Sigma =Qf/w =Qf/(Qch-Qf) car w=(Qch-Qfr) , Nos braves scientifiques déclarent que comme la chaleur = une constante x une température chaude ou froide ,sigma s'écrit: sigma=(Kx Tfr)/ (Kx Tch -Kx Tfr) ,donc on simplifie par K ,constante en question, et il reste: sigma=Tfr/(Tch-Tfr). C'est merveilleux n'est ce pas? Mais le problème est que K a tout d'une variable et rien d'une constante.. Exemple L' eau a 100°C, K = 2253kJ/Kg .A 275°C, K=1580 K J/Kg et à 374.3°C ,K=0 kJ/Kg (température critique). Que les cycles soient a changements de phase ( liquide -gazeuse-liquide,cas des pompes a chaleur et frigos) ou a phase unique ( turbines a gaz) ,K n'est jamais une constante. Je ne sais pas si vous êtes toujours intéressé par les machines MP. Si oui, j’aurai quelques réflexions à vous soumettre. Bon courage |
|
Ecrit le: Mardi 12 Septembre 2006 à 17h43

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
MEG LABO343
5 SEPTEMBRE 2006. Utilisation d’un relais statique inverseur. Pour vérifier le fonctionnement du système de récupération du courant de rupture j’ai donc acheté 2 relais statiques bipolaires CMS. La tension de déclenchement de 1,5 volts étant fournie par une pile. Le but de ces relais était de disposer d’une vitesse de coupure et de contact élevée, favorisant la simultanéité entre coupure de la bobine de commande 1 (par exemple) et contact de la bobine de commande 2. Le résultat efface la piste que j’ai suivie. En effet le courant de récupération tombe de 0,6 à 0,1 ampère. Je suppose que la réactance d’inductance qui agit dans la bobine (de commande) en connexion sur l’alimentation crée une tension supérieure à la tension de récupération dans la bobine (de commande) coupée et de ce fait interdit toute circulation de courant. Ce qui m’induisait en erreur provenait de la non simultanéité entre la coupure de la bobine 1 et la connexion de la bobine 2 : le temps intermédiaire permettait la circulation d’un courant sans opposition . Conclusion, le système à 4 relais devient inutile et je reviens au montage initial sans diodes et avec 2 relais statiques connectés sur les fils + des bobines de commande. 8 SEPTEMBRE 2006. Utilisation d’un générateur de signal carré. Je trouve dans un vide grenier un générateur antique de signal carré et sinusoïdal . Sa fréquence part de quelques hertz (moins de 5) A plusieurs khz. Comme le signal carré est identique à un courant alternatif, il me faut mettre Une diode entre la sortie signal et l’entrée du relais statique inverseur. Premier essai et ça marche ! Je descend la fréquence au minimum et j’obtiens à la sortie du MEG une tension « propre » sans à coups. La valeur de cette tension est 6,6 volts pour une charge constituée par une ampoule de 12 volts 20 watts. La consommation à l’entrée du MEG est de 1,6 ampères contre 2,1 pour la commutation manuelle ( sous 12 volts de tension d’alimentation). Le rendement est médiocre soit 34 ;7%. Mais l’expérience peut largement repartir. En effet le générateur de signal carré confirme plusieurs idées. La première est que le bon signal est carré et non sinusoïdal car je peux commuter en sinusoïdal sur un simple clic et la tension de sortie baisse de moitié. Autre chose : la fréquence de commutation ne fait pas varier la tension de sortie à vide ; en charge la tension de sortie s’écrase au delà de 20 hertz. Ainsi se vérifie le fait que la fréquence efficace de commutation est donnée par le nombre de spires des bobines de commande. Mon générateur de fréquence ne descend pas jusqu’à 1 hertz pour voir si il y a visiblement une fréquence optima mais je le modifierai en insérant un condensateur additionnel sur son circuit oscillant. Autre chose : la consommation du MEG à vide tombe à 0,4 ampères. Surprise. Je me trouve donc en face d’un système qui « récupère » comme un transfo. Autre chose : la tension de sortie à vide est de 15 volts, mesurée sur voltmètre à aiguille, donc pour un courant de charge de 1 ampère traversant l’ampoule de charge sous une tension de 6,6 volts on aura une résistance de l’ampoule de 6,6 ohms et une « résistance » supplémentaire de 8,4 ohms quelque part. Or la résistance des bobines de puissance est de 0,4 ohms. J’en suis là. Autre chose : les bobines de commande sont animées de mouvements mécaniques de répulsion au moment de leur connexion. Ces mouvements sont d’autant plus intenses que la fréquence de commutation est basse et que la charge est faible. Au delà de 20 hertz cela provoque un son gênant. Autre chose : la position des bobines de commande contre l’axe magnétique central ou bien en recul de 2 cm ne change rien au rendement ni à la puissance de sortie. Autre chose : le rendement diminue avec l’augmentation de la fréquence pour un nombre de spires des bobines de commande donné. A 50 hertz la tension de sortie tombe à 4,3 volts pour 0,8 ampères et une consommation de 1,12 ampères sous 12 volts soit 25,6% de rendement. Questions : quel est le mécanisme exact de la récupération à vide ? D’ou provient la chute de tension sur le circuit de charge ? Quel temps met le champ magnétique coupé d’une bobine de commande pour disparaître, sachant qu’aucun extra courant de rupture ne se manifeste ? Quelle est l’incidence de l’épaisseur des bobines de commande sur le rendement ? Quelle est l’incidence sur le rendement du nombre de spires des bobines de puissance par rapport à celui des bobines de commande ? à plus…. |
|
Ecrit le: Mardi 12 Septembre 2006 à 17h56

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO 343
12 SEPTEMBRE 2006 il y a un truc qui me travaille depuis longtemps : la force de Laplace. Influence d'un champ sur un courant. Bon. Un courant continu circulant dans un conducteur rectiligne crée un champ magnétique circulaire autour de ce conducteur. Si ce conducteur rectiligne est placé dans les conditions de la force de Laplace il se déplace. Si on ramène ce conducteur à son champ magnétique, la force de Laplace se ramènerait donc à une interaction entre 2 champs magnétiques. Donc si on remplacait le conducteur par son expression géométrique en tant qu'aimant permanent, pourrait on obtenir une force dont l'origine importe peu mais dont l'usage serait gratuite? |
|
Ecrit le: Jeudi 21 Septembre 2006 à 21h42

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
21 SEPTEMBRE 2006.
MEG LABO343 Expériences sur le rendement. L’utilisation des relais statiques puis de l’inverseur électronique et maintenant du générateur De tension rectangulaire m’a permis de maîtriser la forme du courant utilisé dans les bobines de commande. Evidemment je me suis empressé de vérifier des hypothèses formulées auparavant. La plus marquante est l’importance de la constante de temps des bobines de commande. Mon générateur démarre vers les 5 hertz et je l’ai calé sur 15 hertz. Ensuite j’ai débobiné les bobines de commande pour chercher le nombre de spires qui « produiraient » La puissance maximale en sortie de MEG pour une tension donnée (12 volts). Je me suis rendu compte en premier que les deux bobines de commande réagissaient de façon inégale Et j’ai débobiné celle qui produisait le moins de puissance en premier. 30 spires pour égaliser. Ensuite j’ai débobiné chaque bobine par 5 spires en notant les résultats. En enlevant 100 spires en tout je suis arrivé aux valeurs suivantes : fréquence de commutation en signal carré 15 hertz. Courant de sortie ( sur une charge de 12 volts 20 watts) 1,35 ampères avec une tension de 11,2 volts soit 15,12 watts. Courant d’entrée 3,3 ampères sous 12 volts soit 39,6 watts. Rendement 38,18%. Toujours faible mais nettement mieux que la dernière expérience car j’ai modifié un paramètre : le nombre d’aimants. J’ai formulé l’hypothèse que le rendement augmenterait en disposant plusieurs aimants en parallèle pour diminuer la « résistance » au flux inverse des bobines de puissance. Ce que je craignais était d’atteindre la saturation générale du circuit magnétique et de « bloquer » le dispositif du MEG. Cela a l’air de s’avérer. Il faut donc refaire le test des aimants en parallèle avec des unités magnétiques de faible induction : à voir… Il y avait 4 aimants sur mon MEG et il n’en reste qu’un seul. Les test se poursuivent ainsi. Tout au long du débobinage je suis resté sur un rendement voisin de 40% après suppression des autres aimants. 40% c’est curieux et le plus curieux c’est le fonctionnement sur une seule bobine de commande : le rendement tombe de moitié : 20% ! Je l’avais plus ou moins aperçu avec la commutation manuelle mais là c’est net. Le fonctionnement sur une seule bobine de commande c’est l’expression du fonctionnement « transfo ». Mais ou passe l’énergie consommée ? La résistance ohmique des bobines de commande grignote environ 40% avec les bobines de commande en fil relativement fin. Je sais comment faire pour diminuer cette perte : utiliser une fréquence de commutation plus élevée avec une constante de temps des bobines de commande plus faible. Cela permettra d’utiliser peu de spires de gros fil donc moins résistant. Soit. Autre chose : la forme des bobines de commande : je ne suis plus sur des bobines plates mais sur des bobines « carrées » Et ça change en rien le rendement. Autre chose : je pensais que les bobines de puissance devaient être « accordées » avec les bobines de commande. Et bien non : le nombre de spires Des bobines de puissance par rapport aux bobines de commande ne modifie pas le rendement En dehors de la résistance ohmique. Ce qui sort des bobines de puissance c’est du courant rectangulaire et les diodes servent simplement à séparer les sens indésirables du courant pour l’utilisation. Autre chose : avec la commutation manuelle la consommation à vide et en charge était pratiquement la même : avec la commutation électronique on trouve une intensité à vide Comparable au fonctionnement « transfo ». 0,4 ampères à vide pour 3,3 en charge. Qu’est ce qui a changé ? A mon avis c’est la séquence de la commutation manuelle qui ne permettait pas à la réactance d’inductance de s’exprimer à temps. Je ne sais toujours pas ou passe l’énergie stockée dans l’inductance des bobines de commande lors de leur déconnexion sans étincelle. Je sais que je ne peux pas la récupérer dans le circuit à diodes imaginé précédemment à cause de la barrière des tensions mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas trouver autrement. A suivre… |
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres:
 Pages: (87) 1 [2] 3 4 ... Dernière » Pages: (87) 1 [2] 3 4 ... Dernière » |
   |
[ Script Execution time: 0.1874 ] [ 13 queries used ] [ GZIP activé ]




