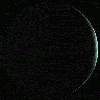
| chercheursduvrai.fr |
 Aide Aide
 Recherche Recherche
 Membres Membres
 Calendrier Calendrier
|
| Bienvenue invité ( Connexion (Log In) | Inscription (Register) ) | Recevoir à nouveau l'email de validation |

 To view this board in english, you must be registered.
To view this board in english, you must be registered.| Pages: (87) « Première ... 17 18 [19] 20 21 ... Dernière » ( Aller vers premier message non lu ) |    |
|
Ecrit le: Mercredi 27 Février 2008 à 19h00

|
|||
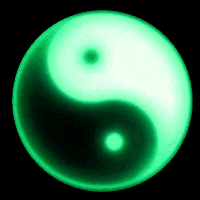 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 4296 Membre n°: 276 Inscrit le: 11/06/2007 |
Hello Tous Bonjour LABO Pour la grippe, je prends un verre de lait tiède dans lequel je mélange une gousse d'ail ecrasée ou hachée menu, avec 1 ou 2 sucre .. On mélange tout ça et hop cul sec, on boit d'un trait. Le soir de préférence .. L'ail est un puissant antiseptique .. Dommage pour l'haleine, mais faut faire avec un jour ou deux .. A plus Amateur aux recettes de grand mère -------------------- Peuple de France, tranche dans le lard en sachant faire une addition des voix Vote à 100% pour Mélenchon, le seul qui parle de paix et de partage des richesses |
||
|
Ecrit le: Jeudi 28 Février 2008 à 17h49

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
Bonjour à tous. Je viens de me faire "une chaleur" avec le test MEG. J'ai connecté le test avec un élément supplémentaire de 2 volts pour avoir donc 14 volts de tension d'alimentation. J'ai pas eu le temps de faire "on" que le fusible a claqué. Rebelotte et clac à nouveau. Investigation: mesure à l'oscilloscope du signal de commande et du fonctionnement du relais de puissance à vide. Tout est OK, pas de faux contact. Le fusible est de 16 ampères. Il en passe 5 pendant le test en 12 volts. J'ai jamais testé la bobine de 28 spires au dessus de 12 volts. Avec 14 volts je pensais avoir une croissance de 20% au plus de l'intensité à vide. Mais pas un claquage de fusible. Hypothèse : le test en 12 volts est tout près d'un phénomène très fort et à 14 volts ca a basculé. La réactance à vide de la bobine primaire se serait totalement effondrée dès le début de la séquence de connexion, entrainant le passage d'un courant à seule limite ohmique qui a claqué le fusible. Je vais faire un test avec moins de tension d'alimentation et je vais voir si la courbe de réactance à vide dessine un L plus "gras", c'est à dire si la partie réactante est plus longue pendant la connexion. A plus |
|
Ecrit le: Vendredi 29 Février 2008 à 09h06

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
29 FEVRIER 2008. Influence du champ magnétisant sur la réactance du test à vide. Dès l’instant de la connexion le champ magnétisant est entièrement installé. Le champ magnétisant est défini (pour une bobine donnée) par la tension d’alimentation présente aux bornes de cette bobine. Le champ magnétisant n’est pas le champ magnétique. Le champ magnétique est développé par le champ magnétisant pendant la durée de la constante de temps. La constante de temps est indépendante du champ magnétisant. La grandeur du champ magnétisant définit l’intensité du champ magnétique réalisé à un instant donné de la constante de temps. Prenons l’exemple du test MEG. La constante de temps de la bobine primaire est de 5 millisecondes. Dans le test effectué sous 12 volts, l’accrochage des champs antagonistes incident et résident a lieu à la fin du premier tiers du temps de connexion. Il aura donc lieu avant si la tension d’alimentation est supérieure et après si elle est inférieure. C’est cela que je vais vérifier. Partant de cette hypothèse il n’y aura pas besoin de retarder la connexion du circuit de puissance (bobine secondaire). Il suffira d’augmenter la tension d’alimentation de façon à diminuer le délai d’accrochage des champs opposés. De plus il semblerait que l’augmentation de la tension d’alimentation de la bobine primaire influe sur la quantité de réactance résiduelle après accrochage des champs en la diminuant jusqu’au point de la supprimer pour une tension d’alimentation donnée. La limitation de l’intensité à vide à 5 ampères pour le test de 12 volts serait donc due à la réactance restante, visible sur la courbe de l’oscilloscope. Comment doit on resituer l’égalité de consommation à vide et en charge dans la logique de cette nouvelle hypothèse ? Pourquoi la charge ne « marque » pas la consommation ? A plus… |
|
Ecrit le: Samedi 01 Mars 2008 à 11h23

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
Bonjour à tous. Finalement je vais tester l'alimentation de la bobine primaire en 2 volts. Cela pour descendre au plus bas de l'échelle des tensions disponibles avec une résistance interne négligeable du générateur. J'ai récupéré un élément de batterie au plomb de 200 ampère-heure. A voir... |
|
Ecrit le: Samedi 01 Mars 2008 à 18h47

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
1° MARS 2008. 18 heures
LABO 343 MEG Bonsoir à tous. Expérience en 2 volts. Test à vide : la tension de réactance passe par un pic instantané aussi haut que lors de l’alimentation en 12 volts. Cependant le reste de la courbe est totalement écrasé. Le bruit à vide est très marqué et disparaît quasiment en charge. Le rapport de changement de bruit est supérieur au fonctionnement en 12 volts. En charge la tension de réactance occupe un tiers de division verticale de mesure de l’oscilloscope alors qu’à vide le pic de tension occupe trois divisions verticales de mesure. La courbe de tension de réactance en charge baisse de moitié du début à la fin de la connexion. Donc la vitesse d’accrochage des flux n’est pas lié à la croissance de la tension d’alimentation. En 2 volts l’accrochage des flux est quasi immédiat. Par contre la crête de tension à vide ne peut pas provenir de la tension d’alimentation Car elle est bien plus élevée qu’elle. La consommation (minime) à vide est toujours la même qu’en charge. La tension de réactance augmente en charge par rapport au fonctionnement à vide après le pic de départ, ce qui est toujours l’inverse que dans un transfo. Le bruit à vide est l’expression acoustique de la crête de tension Le mystère de ce test est toujours aussi épais. A plus... |
|
Ecrit le: Mercredi 05 Mars 2008 à 18h58

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
5 MARS 2008. Bonsoir à tous. Traversée du temps. Quelle que soit la nature de la charge, cela se manifeste par une intensité. Seule varie la courbe de la grandeur de cette intensité pendant le temps de son existence en fonction de la nature de la charge. Donc « l’effet en retour » de la charge sur le test MEG est causé uniquement par le passage d’une intensité dans la bobine secondaire (de puissance). Dans un transfo classique la charge s’oppose à la réactance de la bobine primaire et crée un « appel de courant » de consommation. Dans le MEG « quelque chose » s’oppose déjà à la réactance de la bobine primaire. Or normalement la charge s’oppose à une situation de l’instant, même si cette situation est déjà Une opposition à une autre situation immédiatement antérieure . Je pense que tout le débat est là. Si l’opposition s’oppose à une opposition on doit avoir baisse de la consommation grâce à la charge. Si l’opposition s’ajoute à l’opposition on doit avoir hausse de la consommation grâce à la charge. Mais l’égalité de consommation à vide et en charge n’a pas d’explication. Le test en 2 volts écarte l’idée d’une distribution des actions dans le temps car dans ce cas La baisse de réactance est quasi instantanée : il n’y aurait pas égalité d’actions antagonistes. Il reste à voir du coté de la curieuse crête de tension se manifestant au début du fonctionnement à vide : cette crête bruyante même en 2 volts et qui « disparaît » en charge. Il y a peut être quelque chose à voir avec la « traversée du temps », une perturbation de l’ordre de défilement de la cause et de la conséquence. Dans le test en 2 volts la charge semble avoir effacé sa cause jusqu’avant la ligne d’origine du temps. A plus… |
|
Ecrit le: Lundi 10 Mars 2008 à 15h29

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
10 MARS 2008. Bonjour à tous. Expérience de connexion inverse de la bobine de commande. Dans les tests précédents la bobine de commande est connectée de façon à ce que son champ s’oppose au champ de l’aimant permanent. J’ai donc connecté à l’inverse, de façon à ce que le champ de la bobine s’ajoute au champ permanent. Le résultat est évidemment surprenant : à vide la courbe de réactance est la même que lors de la connexion opposée. C’est une courbe en forme de L et la consommation à vide est identique. Si je branche la charge sans avoir inversé le sens de la diode, j’ai une production d’énergie faible et une augmentation de la consommation de 3 ampères. Par contre la courbe de réactance ne change absolument pas !!! C’est toujours le même L, que la charge soit branchée ou non… Ainsi on a une consommation supplémentaire avec une courbe de réactance identique… De plus en plus obscur… A plus... |
|
Ecrit le: Lundi 10 Mars 2008 à 19h34

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Bonsoir à tous.
La crise se précise : 19 H , le prix du brut west texas est de 107,91 dollars par baril vu sur http://www.bloomberg.com/energy/ a plus... |
|
Ecrit le: Jeudi 13 Mars 2008 à 12h44

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
13 MARS 2008.
LABO343 MEG Bonjour à tous Hypothèse du conflit. L’alimentation en 2, 12 et 14 volts montre à chaque fois une crête de tension au début de la séquence de connexion. La différence entre ces crêtes est leur durée : elle augmente avec la tension d’alimentation. Je pense donc que ces crêtes représentent la phase initiale du conflit et que la durée de ces crêtes est fonction du champ magnétisant de la bobine de commande. La phase suivante du conflit est l’écrasement de la tension de réactance qui entraîne la forte consommation à vide. Le test avec branchement inverse montre que le conflit est présent quel que soit le sens de la bobine de commande. Cela amène à penser que le conflit se situe sur la périphérie du circuit magnétique ou il y a toujours un demi circuit magnétique dont les lignes de force sont en opposition avec celles de la bobine de commande. Maintenant, évidemment je me demande comment se fait le « retour d’influence » sur la bobine de commande. Dans le cas de la bobine connectée en opposition avec le flux permanent qui la traverse c’était facile d’expliquer. Dans le cas maintenant avéré de symétrie des sens de connexion, il ne reste plus Qu’à considérer le flux de la bobine de commande dans son entier parcours du périmètre du circuit MEG. L’action sur la réactance serait donc amenée par une modification d’un paramètre du flux de la bobine de commande en conflit avec le flux permanent. Contradiction En charge l’intensité de la consommation augmente avec le temps dans la séquence de connexion. Or la courbe de la tension secondaire baisse dans le même temps, ce qui est contradictoire puisqu’une tension décroissante ne peut pas générer un courant croissant dans une charge ohmique donnée. Cela signifie que la forte intensité de consommation en fin de séquence de connexion ne peut pas être affectée à l’intensité passant dans la charge au même moment. Supercondensateur. J’ai lu sur Internet que des supercondensateurs étaient utilisés pour compenser le temps de réponse insuffisant des batteries dans les véhicules électriques. Cela me donne une nouvelle piste. Le temps de réponse de la batterie au plomb que j’utilise (45 Ah) explique peut être la courbe de l’intensité à vide très décalée avec la courbe de réactance. Je vais donc rechercher un supercondensateur pour voir si cela modifie les courbes. A plus… |
|
Ecrit le: Jeudi 13 Mars 2008 à 12h53

|
|
 Expert(e)       Groupe: Modérateurs Messages: 4027 Membre n°: 181 Inscrit le: 07/10/2006 |
Bonjour à tous,
Labo343, ne te prends pas la tête à trouver des supercondensateurs, Avec des condos électrochimique de forte valeur facilement trouvable ça le fera bien. Tu attrape 3 ou 4 condos de 22000 µF 20V en parallèle sur la batterie ça va t'aider. A+++ -------------------- Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie.
Page YouTube, Page Dailymotion, Album Picasa, La Force contre-électromotrice, simulation magnétique, Viktor Schauberger |
|
Ecrit le: Jeudi 13 Mars 2008 à 16h12

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
13 MARS 2008. BIS
LABO 343 MEG Test de réponse temporelle de la batterie. Au passage merci pour ton conseil Quartz mais tu vas voir c'est plus la peine. J’ai remplacé la bobine de commande par l’ampoule de charge : 12 volts 50 watts, soit environ 3 ohms. J’ai inséré entre la batterie et le circuit du relais statique et de la charge une résistance de 1 ohm et de gros volume de dissipation thermique. J’ai branché l’oscilloscope aux bornes de cette résistance. Ainsi la tension apparaissant à ces bornes peut se transposer en lecture de l’intensité du circuit total. Lorsque je connecte la batterie le signal lu sur l’oscilloscope est parfaitement rectangulaire. Pas l’ombre d’un signal courbé. La seule variation concerne la tension de ce signal qui est plus élevée quand l’ampoule prend sa température de fonctionnement : sa résistance est alors moindre. Cela dure une seconde et C’est une ligne droite segmentée qui baisse dans son ensemble, à l’horizontale. La conséquence est que la batterie et le relais statique sont absolument étrangers à la courbe D’intensité mesurée avec la bobine de commande à vide et en charge. Pas besoin de supercondensateur en remplacement de la batterie : le problème n’est définitivement pas là. Retour au jeu des réactances et des intensités. Tout à l’heure j’ai oublié de dire que j’avais refait le test en14 volts et que rien n’a sauté. Je sais toujours pas ce qui s’est passé. Je fais pourtant très attention aux faux contacts. Il a du y avoir une mini oxydation. Je ne pouvais pas rester sur cette peur du court circuit dévastateur. Après avoir vérifié toutes les sécurités de connexion j’ai refait le test. Consommation à vide et en charge : 7 ampères, soit 98 watts. En 12 volts la consommation était de 5 ampères soit 60 watts. La charge ne suit pas cette progression : l’ampoule de 50 watts aurait du exploser : elle tient. La consommation a l’air d’être liée à la tension d’alimentation par une courbe exponentielle, Que ce soit à vide ou en charge. La courbe de la tension de réactance à vide est presque identique au test en 12 volts. La partie verticale du L est à peine un peu plus épaisse. En 14 volts le champ magnétisant est de 196 ampères-tours contre 140 en 12 volts. Pour mémoire la première bobine du test MEG comportait 200 spires : en 12 volts et sous 5 hertz en charge la consommation était de 1,6 ampères soit un champ magnétisant de 320 ampères-tours. La résistance ohmique de cette bobine était de 3 ohms (celle de la bobine actuelle est de 0,017 ohm). La production était de 6 watts environ, soit un mauvais rendement. A plus... |
|
Ecrit le: Vendredi 14 Mars 2008 à 10h55

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
14 MARS 2008.
LABO 343 MEG Bonjour à tous. Tout se passe dans le MEG Suite au test d’intensité hors MEG, j’ai la conviction que les anomalies sont bien situées à l’intérieur du circuit magnétique et des bobines. Donc la différence entre la courbe de réactance à vide et la courbe d’intensité correspondante Ne provient pas de la batterie ni du relais statique. La courbe de réactance à vide devrait entraîner une courbe d’intensité en forme de L inversé, donc rectangulaire. Ce n’est pas le cas. Il y a donc intervention d’un phénomène non identifié, agissant sur le paramètre temps. Dans le cas du test en charge, comment expliquer que l’intensité de consommation augmente au même moment ou la tension sur la charge diminue ? C’est logiquement « impossible ». La charge est une résistance ohmique et la puissance dissipée est uniquement fonction de la tension aux bornes. Donc une tension minime entraîne un courant minime. Cela veut dire que la puissance maximale dissipée dans la charge se produit au moment ou la consommation est minimale sur la bobine de commande : d’ou vient donc l’énergie à ce moment précis ? A plus… |
|
Ecrit le: Vendredi 14 Mars 2008 à 12h01

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
14 MARS 2008bis Il s’agit donc d’une preuve. La séquence de connexion en charge dure environ 5 millisecondes. Au début de cette connexion la puissance dissipée par la charge est maximum et la puissance consommée par la bobine de commande est minimum. On a donc une extraction d’énergie du « vide » en début de séquence de connexion qui diminue avec la pente de la tension sur la charge. Au même moment on a une consommation sur la bobine de commande qui augmente. Lorsque cette consommation est maximum, il n’y a aucune trace de dissipation de cette puissance : je pense donc que l’énergie « plonge dans le vide » en fin de séance de connexion dans le circuit de la bobine de commande. Le plus important évidemment c’est « l’extraction » de l’énergie du « vide » dans le circuit de la charge. Je crois que la preuve est définitivement établie sur ce test très simple à reproduire. http://video.google.fr/videoplay?docid=-4148989027527286664 Puisque les deux mouvements d’énergie ne sont pas calqués il doit y avoir moyen de les dissocier : étape suivante. A plus... |
|
Ecrit le: Vendredi 14 Mars 2008 à 19h01

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
14 MARS 2008. ter
LABO343 MEG Test en 150 hertz. Lorsqu’on passe de 95 à 150 hertz en charge, la brillance de la lampe augmente pour une même tension d’alimentation et malgré le fait que la constante de temps de la bobine ne change pas. Pourquoi ? Parce que la courbe de tension est décroissante sur le circuit de la charge. Ainsi l’augmentation de la fréquence a pour effet de raccourcir la séquence de connexion. La conséquence est que la partie haute de la courbe de tension est favorisée. Une mesure avec le métrix signale que l’on passe de 11,5 volts en 95 hertz à 13 volts en 150 hertz, mesure faite aux bornes de la charge. Bien que la mesure ne soit pas « exacte » en elle même (à cause du changement abrupt de tension), la hausse de la tension « moyenne » est manifeste. Dans ce même test l’intensité à vide chute à 3 ampères environ en 150 hertz, mais la charge de 50 watts sous 12 volts (soit 2,6 ohms environ) conserve la consommation à 5 ampères environ bien que sa tension passe à 13 volts. La production avoisinerait donc les 60 watts, ce qui se rapproche de la consommation. L’augmentation de la fréquence dans ce cas augmente le rendement. Il y a dans ce cas décrochage entre consommation à vide et en charge. A 200 hertz la consommation à vide est toujours d’environ 3 ampères mais en charge on monte à 7 ampères avec une très forte brillance de la lampe. Si je place une charge de 11 ohms l’intensité en charge est toujours de 3 ampères. Il y a donc influence du champ magnétisant maximum de la charge sur la bobine de puissance. On ne doit pas dépasser un nombre limite d’ampères-tours défini par celui de la bobine de commande sous une tension donnée. Il y a donc une valeur de résistance de charge optimale à chercher à chaque variation de la fréquence ou de la tension d’alimentation. A plus.. |
|
Ecrit le: Samedi 15 Mars 2008 à 16h27

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
15 MARS 2008. Bonjour à tous. Tension crête sur la bobine secondaire. La tension crête de la bobine de puissance est de 68 volts en 95 hertz, 66 volts en 150 hertz Et 70 volts en 40 hertz. Tout ceci avec une tension d’alimentation de 12 volts. Voilà comment j’ai fait la mesure : j’ai enlevé la charge et j’ai mis à la place un condensateur Electrochimique de 100 microfarads sous tension maxi de 100 volts continu. Vu que le circuit de charge est traversé par une diode le repérage des polarités est immédiat. Puis j’ai connecté le MEG et j’ai branché le métrix en position courant continu sur les bornes du condensateur. Le condensateur n’étant pas un dissipateur d’énergie, il va se charger jusqu’à la tension extrême appliquée. Cependant il y a une surprise. Test de crête avec une tension d’alimentation de 2 volts : 65 volts en 95 hertz, 63 volts en 150 hertz et 68 volts en 40 hertz. Observations : la tension crête n’augmente pas avec la fréquence (elle diminue même un peu) Une baisse de 84% de la tension d’alimentation entraîne une baisse de 3% de la tension crête !! J’en déduis que la tension d’alimentation n’est pas reliée à la tension secondaire comme dans un transfo classique ou toute variation de tension primaire se retrouve dans la même proportion dans la tension secondaire (dans le respect de la non saturation magnétique). Dans le test en 2 volts, si on connecte la charge de 12 volts 50 watts, la brillance de la lampe ne sera pas du tout la même qu’en alimentant le MEG en 12 volts. Puisque la crête de tension est quasi la même en 2 et 12 volts, la différence d’énergie fournie se fera sur la durée de cette crête comme le confirment les courbes de réactance à vide en 2 et 12 volts. A plus… |
|
Ecrit le: Mardi 18 Mars 2008 à 17h27

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
18 MARS 2008 Bonjour à tous. La tension crête semble s’apparenter à un « coup de bélier magnétique ». Normalement une tension induite dans une bobine entourant un circuit magnétique fermé ne peut être provoquée que par une variation du flux circulant dans ce circuit magnétique. Si l’on considère la séquence de connexion de cette bobine, on pourra observer que si cette séquence de connexion est inférieure à la constante de temps de la dite bobine, la croissance du flux magnétique produit suit une quasi droite avant d’obliquer. La conséquence est que la tension induite dans cette même bobine au titre de la réactance sera quasi constante avec une baisse en fin de séquence de connexion due à l’approche du seuil de constante de temps. Ce qui se passe dans le test MEG « ne peut donc pas exister » mais est bien observé. Dans un transfo ou les primaire et secondaire ont le même nombre de spires, la tension d’alimentation est identique à la tension de sortie. Dans le cas du test MEG nous sommes dans le même cas de figure concernant les bobines : la variation du flux de la bobine primaire devant entraîner la création d’une tension de réactance dans cette bobine primaire et une tension identique dans la bobine secondaire. Ce n’est pas le cas. Dans le test MEG , la confrontation entre le champ incident et le champ permanent semble entraîner un choc initial comme une vague à l’embouchure d’un fleuve face à la marée montante. La hauteur de ce choc semble indifférente à la tension d’alimentation mais pas sa durée. Meme en 2 volts, si la réactance ne limite pas l’intensité, il y a moyen d’obtenir un fort champ magnétisant dans une bobine de 0,017 ohms de résistance. Pour obtenir une telle tension crête, il faut qu’il y ait un très fort champ magnétisant déployé au terme d’une variation très rapide. Une remarque en passant : la tension de crête à vide mesurée sur la bobine de puissance est le « clone » de la tension de réactance issue de la bobine de commande. On peut donc suggérer que la tension de réactance en début de séquence à vide est supérieure à la tension d’alimentation. La conséquence devrait en être un courant d’anti consommation et donc de recharge de la batterie ! Rien de tel n’est observé sur la courbe d’intensité à vide car le relais statique doit se comporter comme une diode. Il faut observer aussi que cette tension crête viole la loi de l’induction : comment une bobine peut elle produire beaucoup plus que la tension d’alimentation alors que le nombre de spires des deux bobines est égal et que la bobine de commande « travaille » selon sa constante de temps ? On remarquera que cela se produit pendant la connexion et non pas à la coupure comme dans les bobines d’allumage de voiture. La crête de tension est donc la source de l’énergie gratuite sur la charge. Pour récupérer le maximum de puissance d’un générateur il faut que sa résistance soit la même que la charge qui lui est connectée. Partant de cela on peut dire que la tension aux bornes du générateur en charge maximale sera la moitié de la tension à vide. Dans le cas du test MEG, l’intensité maximale productible par la bobine de puissance est définie par le nombre d’ampères-tours au delà duquel l’effet MEG ne joue plus. Cette intensité est facilement repérée par l’expérience car elle entraîne un décrochage entre l’intensité à vide et en charge. L’idée est de rechercher une tension de charge moitié de la tension à vide soit environ 33 volts pour mon test avec bobines de 28 spires. Dans ce cas la puissance dissipée par la charge serait maximale. Donc on cherchera par approches successives une valeur de résistance de charge laissant passer le courant maximum sans dépasser l’égalité de consommation à vide et en charge et qui fonctionnera ainsi sous une tension de 33 volts. Pour une tension standard il faudra adapter le nombre de spires des bobines. Quelque chose doit être remarqué : l’énergie disponible sur la bobine de puissance est essentiellement concentrée au début de la séquence de connexion. Cela correspond au choc initial entre les deux flux magnétiques. A la fin de la séquence de connexion la tension sur la charge est quasi nulle mais l’intensité consommée dans la bobine de commande est maximale. Il n’y a donc pas de « contre – contre réactance » à ce moment. Par contre on peut le dire au début de la séquence de connexion en charge puisqu’on a une tension maximale sur la charge et une consommation minimale sur la bobine de commande. Contrairement à ce que je croyais il y a peu l’énergie gratuite est disponible au début de la séquence de connexion : la conséquence est importante car il est plus facile d’isoler le début de séquence que la fin. Le bruit du fonctionnement du test à vide prend désormais une signification nouvelle : il s’agit bien d’une sorte « d’explosion magnétique » et la charge s’y oppose en atténuant ce bruit. Je rappelle que ce bruit à vide est déjà fort en 2 volts d’alimentation. Désormais je vais me concentrer sur la crête de tension. A plus… |
|
Ecrit le: Mercredi 19 Mars 2008 à 18h36

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
19 MARS 2008. Bonjour à tous. Crête de tension, suite. La crête de tension entraîne un courant donné en fonction de la résistance de charge. Pour une tension d’alimentation donnée, il y a une intensité critique au delà de laquelle les courants moyens de consommation à vide et en charge ne sont plus égaux. Le test en 14 volts montre toujours une égalité de consommation à vide et en charge mais l’intensité de consommation est de 7 ampères et la production sur la charge est une quantité d’énergie supérieure. Pourtant la tension crête est la même. L’intensité crête ne peut pas avoir augmenté : c’est donc la durée de la crête d’intensité qui a augmenté. La charge s’oppose à la durée de la crête et le début de son action est immédiatement postérieure à l’établissement de la crête à vide. Cela se lit sur la courbe de tension de charge Qui démarre depuis le sommet de la crête de tension. Le problème est la forme de la courbe de tension de charge : ce n’est pas un L dont le trait vertical est aminci mais une ligne décroissante vers le bas selon une pente dégressive. Si on augmente la fréquence dans le test en 12 volts, on a un décrochement de la consommation à vide et en charge au delà de 150 hertz. Mais là c’est la consommation à vide qui baisse et pas la consommation en charge. Test avec une deuxième charge de 50 watts 12 volts en parallèle. Total 100 watts (sous 12 v). La courbe de tension de réactance sur la bobine de commande change de forme. La partie de la tension crête est amincie au point de n’être qu’un fil qui descend jusqu’au premier tiers de sa hauteur et puis la courbe reprend vers la gauche comme avec une seule charge. Au niveau de la bobine de puissance la courbe est la même qu’ avec une seule charge mais part de un tiers plus bas au début de la séquence. Cela est l’expression de la baisse de luminosité constatée sur la première et deuxième charge quand cette dernière est connectée. La consommation moyenne pour les deux charges connectées est de 8 ampères, soit pas loin des 100 watts des charges(sous 12 volts). Conséquence : l’addition d’une charge supplémentaire « amaigrit » la courbe de réactance « positive » de la bobine de commande dans sa partie crête. De ce fait le « rendement MEG » diminue. C’est l’action en retour du courant de charge. Il vaut donc mieux augmenter la tension d’alimentation, ce qui agrandit la durée de la crête de tension et donc la quantité de l’effet MEG. En parallèle il faut diminuer la partie de la séquence de connexion qui cause la consommation. En pratique il faudra rester sur une valeur de résistance de charge qui donne une égalité de consommation à vide et en charge. Si on arrive à augmenter le rendement en diminuant la durée de la séquence de connexion, cela diminuera la consommation mais gardera le niveau de production de la charge. La charge prolonge la durée de la réactance positive(effet MEG) de la bobine primaire au delà de son existence à vide mais avec une tension très diminuée et nulle à la fin. Cela ressemble à l’amortissement d’un circuit oscillant non entretenu. A plus… |
|
Ecrit le: Mercredi 19 Mars 2008 à 18h40

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
Juste une petite erreur : "la courbe reprend vers la droite" et non "vers la gauche comme avec une seule charge". A plus
|
|
Ecrit le: Jeudi 20 Mars 2008 à 08h39

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
20 MARS 2008 Bonjour à tous. « amortissement d’un circuit oscillant non entretenu ». La charge fait diminuer la durée de la réactance maximale (effet MEG) observée à vide . Elle commence par s’opposer à la réactance maximale et de ce fait la tension initiale de cette réactance baisse, ce qui entraîne une diminution de la tension secondaire et donc de la capacité d’opposition de la charge sur la tension abaissée et ainsi de suite… Il y a une « chaîne de renvoi des actions » entre les deux bobines qui ne s’arrête qu’avec l’extinction de la tension de la charge. C’est pour cela que la réactance sur la bobine primaire Ne s’effondre pas instantanément sous l’effet de la charge et ne donne pas à observer une courbe de tension rectangulaire. La contre réactance de la charge agit donc de façon « classique » comme dans un transfo. C’est la tension anormalement élevée de la réactance à vide qui crée l’anomalie du MEG. L’augmentation du courant de charge « creuse » la courbe de réactance. L’augmentation de la tension d’alimentation « gonfle » la courbe de réactance : sa vitesse d’effondrement est inférieure. A plus… |
|
Ecrit le: Vendredi 21 Mars 2008 à 11h00

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
21 MARS 2008. Bonjour à tous. Le basculement du flux incident entre deux bobines de commande opposées multipliait la hauteur de la crête de tension : retour en juillet 2005. Mon premier test du MEG comprenait deux bobines de commande opposées de 200 spires chacune. Elles étaient alimentées en 12 volts continu par une batterie au plomb. La commande de connexion était manuelle et utilisait un interrupteur « va et vient ». Les bobines de puissance étaient disposées comme dans le test de Bearden sur chaque demi circuit magnétique. Sur la première vidéo de juillet 2005 on voit très bien l’expression de la crête de tension Sur les ampoules de charge : une tension décroissante. On voit aussi que la bobine de puissance peut se situer n’importe ou sur la périphérie du circuit magnétique double : qu’elle soit sur le même demi circuit que la bobine de commande ou sur l’autre, il y a production d’énergie. Si deux bobines sont branchées simultanément sur une charge elles partagent l’énergie de la crête de tension mais leur propres tensions sont opposées si elles sont situées sur l’une et l’autre branche du circuit magnétique double. Si on ne branchait qu’une seule ampoule sa brillance doublait donc sa puissance. Au vu de ce que je sais maintenant je peux dire que la crête de tension était visible directement à cause de la constante de temps très élevée des bobines de commande à 200 spires. En effet la grande section du circuit magnétique de mon test et le nombre de spires amenait la constante de temps vers les 1 hertz. Le hasard a donc voulu que ce test permette de « voir » la crête de tension sans savoir à l’époque à quoi j’avais affaire. C’est là que se situe le phénomène important : la différence flagrante de puissance de sortie entre le basculement des deux bobines et le « marche / arrêt » sur une seule. La différence de puissance était de plus du double au profit du basculement mais seulement après la première connexion, ce qui en est une confirmation. C’est d’ailleurs ce phénomène bizarre qui m’a donné l’assurance que je « tenais quelque chose de pas très net » et qui m’a encouragé à persévérer. Maintenant je peux dire que le test de juillet 2005 dévoilait un mécanisme de « soupape de l’énergie de l’espace » au stade rudimentaire. La durée de la crête de tension dépend de ce que j’appellerai « le champ magnétisant du début des opérations ». Pour préciser c’est la tension aux bornes d’une bobine d’un nombre de spires donné à l’instant précis de la connexion sur la source d’énergie et donc avant que ne commence le jeu des réactances. Dans le cas de l’expérience de 2005 cette tension de 12 volts se présentait aux bornes d’une bobine de 3 ohms et 200 spires soit un « champ magnétisant du début des opérations » de 800 ampères tours. Donc ce champ initial conditionne la durée d’ouverture de la « soupape d énergie » et l’aimant permanent définit la hauteur de la crête de tension. Le fait que le basculement de la connexion de deux bobines opposées entraîne la multiplication de la hauteur de la crête de tension nous renseigne sur la nature de cette crête. Je ferai une image de comparaison avec une brosse à cheveux. Supposons un coiffure « en brosse » aux cheveux verticaux. Passons la brosse dans un sens : les cheveux s’inclinent dans le sens de la brosse d’une longueur comprise entre la position initiale et la position acquise. Si on passe la brosse immédiatement en sens inverse les cheveux seront inclinés dans l’autre sens mais auront parcouru le double de chemin que dans la première action. Dans le test de 2005, si l’on changeait la polarité de l’alimentation des bobines de commande, Il y avait toujours la même production d’énergie : cela veut dire qu’une partie du circuit magnétique double était toujours le siège de l’effet MEG. Dans ce test le basculement entre les deux bobines de commande se faisait en observant un « temps de silence », c’est à dire un temps de déconnexion des deux bobines au milieu du basculement. Ce temps de silence ne nuisait pas au phénomène de multiplication de la hauteur de la tension crête sauf s’il était trop long. Il faut revoir cela de très près. A plus… |
|
Ecrit le: Vendredi 21 Mars 2008 à 11h47

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 139 Membre n°: 631 Inscrit le: 05/09/2007 |
Salut LABO343,
depuis pas mal de lectures sur le MEG, cela me fait penser au MRA http://www.rexresearch.com/mra/1mra.htm et http://www.rexresearch.com/mra/2mra.htm apparemment la frequence mise en jeu est au alentour de 17 kHz et le core est a base de barium ferrite magnet (alinco), seul l'architecture du circuit par rapport au MEG differe pour peut etre un meme resultat ??? Bonne lecture, it's in english of course. GEO |
|
Ecrit le: Vendredi 21 Mars 2008 à 12h27

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343
Bonjour à tous. Merci pour l'adresse, Geotrouvetout mais ma pratique de l'Anglais est quasi nulle. Ce que je sais c'est que la fréquence plafond de mes relais est de 700 hertz et que pour 17 khz il faudrait surement une bobine de commande de 2 ou 3 spires dans mon test. Pour le moment je suis bien au dessous de cela. Mais la recherche de la puissance passera par l'augmentation de la fréquence, c'est sur. Je dois d'abord finir d'identifier le mécanisme de la crete de tension car c'est une nouvelle piste très fertile. A plus pour de nouveaux résultats de test... |
|
Ecrit le: Vendredi 21 Mars 2008 à 18h56

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
21 MARS 2008. B Sens de la tension crête. Test : changer le sens de connexion de la bobine de commande. Cependant les connexions en + et en – pour l’oscilloscope restent les mêmes : le + branché en sortie du relais statique et le – sur le pole – de la batterie dans tous les cas. Donc avant le test d’inversion de sens de la bobine je vérifie le sens de la crête de tension : il est dirigé vers le haut de l’écran de l’oscilloscope. Résultats : le sens de la crête de tension est identique, vers le haut. Les performances sont exactement les mêmes, que ce soit en 95 Hz, en 150 Hz ou en 200 Hz. Dans le cas des mesures en charge j’ai pris soin d’inverser aussi les connexions de sortie de la bobine de puissance, sinon on ne capte presque rien sur la charge : la diode ne laissant passer que la tension issue de la croissance du flux de la bobine de commande. Donc au niveau du circuit magnétique situé « sous » la bobine de commande on ne peut pas attribuer l’effet MEG à une opposition au flux permanent. Il y a indifférence au sens du flux. Donc on peut « réveiller » l’hypothèse du « verrou » magnétique par utilisation de la « densité de champ magnétisant ». Cette densité serait définie par le nombre d’ampère tours présents le long de la bobine de commande. La bobine du test fait 1 centimètre. Je ne connais pas le champ magnétisant réel en début de connexion sur la bobine de commande en 12 volts mais si on prend comme mesure l’intensité moyenne à vide ( 5 ampère) on aura une densité de champ magnétisant de 14000 ampères tour par mètre. Pour comparaison, dans le test de juillet 2005 on avait une densité de champ magnétisant de 80000 ampère tour par mètre avec une bobine de 200 spires, un courant de 4 ampère ( pour une résistance de 3 ohms) et une longueur de 1 centimètre. Reste à voir la relation avec la genèse de la crête de tension. A plus… |
|
Ecrit le: Vendredi 21 Mars 2008 à 19h00

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
21 MARS 2008. C Raisonnement à rebours. Lors de la croissance du flux d’une bobine dans un circuit magnétique fermé ( et sans aimant permanent) il se développe une tension de réactance dont le sens est opposé à la tension d’alimentation . La hauteur de cette tension de réactance ne peut pas dépasser la hauteur de la tension d’alimentation. Une charge placée sur une bobine voisine fait baisser cette tension de réactance et « appelle le courant de consommation ». Pour que la tension de réactance monte plus haut que la tension d’alimentation il faudrait que la croissance du flux initial entraîne instantanément la croissance d’un flux supplémentaire. Ce n’est pas le cas avec l’aimant permanent dont l’induction est définie par sa propre matière et ne peut varier vers le haut. Pourtant on observe une tension crête de réactance qui semble dire qu’il y a dans le circuit magnétique une augmentation du flux en début de séquence de connexion plus forte que sa cause. Ce phénomène semble aussi lié à l’utilisation d’une bobine plate. La bobine ne peut agir que sur le flux qui la traverse ou sur ce qu’elle traverse par son flux. La bobine ne peut recevoir d’influence que des flux qui la traversent ou de la matière située en son centre. Or, à vide l’existence de la tension crête ne peut pas provenir du flux extérieur. La tension crête est donc causée par la modification de la matière présente « sous » la bobine de commande, par le double effet d’un flux résident permanent et d’une forte densité de champ magnétisant incident. A plus. Ca avance... |
|
Ecrit le: Samedi 22 Mars 2008 à 19h36

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
22 MARS 2008. Bonsoir à tous. Définition de la partie gratuite de la courbe de tension de réactance. Commençons par étalonner l’oscilloscope avec la tension directe de la batterie. Je règle l’affichage de la tension 12 volts sur une hauteur d’une unité du cadrage de l’écran. Ensuite je reconnecte la bobine de commande et je lance la connexion du MEG à vide. Je mesure 5,5 unités de hauteur sur le cadrage de l’écran pour le sommet plat de la courbe de tension en L. Cela correspond aux 68 volts mesurés sur le condensateur de 100 microfarads. En charge le sommet de la courbe de tension est au même niveau que le sommet plat à vide. Toute la partie de la courbe qui est au dessus de 12 volts ne peut pas consommer du courant car le récepteur à toujours une tension inférieure à la source. Donc si on copie l’écran de l’oscilloscope sur un graphique on peut définir la partie gratuite de la production du test MEG. Je constate aussi que lors de la déconnexion il apparaît une tension de 12 volts légèrement décroissante et de sens inverse aux bornes de la bobine de commande. Cette tension ne peut pas provenir de l’alimentation puisqu’elle est déconnectée. Cette tension inverse apparaît aussi bien à vide qu’en charge et ne peut donc pas être imputée à la bobine de puissance. Cela n’a pas d’influence sur la consommation puisqu’ il y a aussi déconnexion. On comprend définitivement pourquoi la charge ne « marque pas » la consommation : la courbe de tension de réactance qu’elle induit est presque toute supérieure à la tension d’alimentation. Si l’on reporte les crêtes de tension à vide sous 2 , 12 et 14 volts sur un graphique, on se rend compte que ces tensions quasi égales correspondent à une vitesse de croissance du champ magnétique bien plus élevée que ne le permettrait la constante de temps de la bobine de commande. Je formule donc l’hypothèse que « l’effet MEG » est une modification de la constante De temps de la bobine de commande. Les conditions pour y parvenir sont un flux magnétique permanent associé à un champ magnétisant de forte densité activé sur une bobine qui entoure ce flux permanent. La constante de temps de la bobine est raccourcie en fonction de la grandeur de l’induction de l’aimant permanent. La durée de l’effet MEG est fonction de l’intensité du champ magnétisant de la bobine. L’effet MEG est gratuit tant que la tension de réactance sur la bobine ou il se produit est supérieure à la tension d’alimentation. LABO343 samedi 22 mars 2008 à 19H 33. A plus… |
|
Ecrit le: Lundi 24 Mars 2008 à 09h44

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
24 MARS 2008. Bonjour à tous. Précisions sur la courbe de réactance à vide en forme de L Lors de mes premières mesures à l’oscilloscope j’ai été frappé par la courbe de réactance à vide de la bobine de commande. J’ai décrit ce que je voyais à l’écran : une courbe inattendue. Je n’ai pas trop prêté attention au réglage de la base de la tension sur l’écran et j’ai défini la base du « L » comme étant un faible réactance résiduelle. En fait la base du « L » est à zéro ! Ce qui m’a induit en erreur c’est la faible tension inverse présente après la fin de la séquence de connexion. Je l’ai pris pour un décalage de la base de tension. Après avoir fait un étalonnage des unités graphiques de l’écran de l’oscilloscope j’ai vérifié que cette tension résiduelle inverse est égale au début puis inférieure à la tension d’alimentation. Pour le moment je pense qu’il s’agit d’une « ombre » de la tension d’alimentation liée au fonctionnement du relais statique. Cette tension inverse n’a pas de fonctionnalité apparente dans le bilan d’énergie du test puisqu’elle apparaît hors connexion et qu’elle est indifférente à la présence de la charge. En effet la courbe de tension de réactance en charge présente le même phénomène de tension résiduelle inverse après déconnexion. Tout ceci confirme que la bobine de commande soumise au champ permanent et à la forte densité de champ magnétisant de l’alimentation se comporte comme si elle changeait de Constante de temps en la diminuant fortement. De plus on représente normalement la constante de temps comme une ligne quasi droite au début mais qui s’incurve rapidement après un seuil. Dans le test MEG la courbe est quasi rectangulaire, ce qui donne à penser que le phénomène est violent. A plus… |
|
Ecrit le: Lundi 24 Mars 2008 à 13h43

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
24 MARS 2008 B Bonjour à tous. Précisions sur la courbe d’intensité à vide et en charge. Base d’étalonnage. Je pars de la lecture de mon « métrix » digital. Je branche une grosse résistance bobinée de 1 ohm environ en série avec l’ampoule de 12 volts 50 watts et la batterie de 12 volts , 45 ah. L’intensité mesurée est de 3,32 ampères lorsque les températures sont stabilisées. Je connecte l’oscilloscope aux bornes de la résistance de 1 ohm et j’ajuste la hauteur de signal obtenue à une unité verticale du cadran de lecture de l’oscilloscope. Chaque unité de cadran verticale vaudra donc 3,32 ampères. Je connecte le MEG en insérant la résistance de 1 ohm sur l’alimentation. Je règle la fréquence de connexion du MEG à 95 Hz. La courbe d’intensité déjà décrite affiche une crête En fin de connexion d’une valeur de 3 unités de cadran exactement, soit 10 ampères. Cette lecture est la même à vide et en charge. La présence de la résistance de 1 ohm en série sur l’alimentation fait baisser la tension aux bornes du relais statique de commande à 8 volts exactement. Ceci est identique à vide et en charge. Je veux savoir ce qu’il en est avec une tension aux bornes du relais statique de l’ordre de 12 volts. Pour cela je refais un étalonnage de la résistance de mesure en utilisant une partie de celle ci. Cette résistance comporte 24 spires de 1,5 mm de diamètre. Je me connecte sur 4 spires. Le même étalonnage du départ affiche 4,1 ampères lorsque les températures sont stabilisées. Je refais le test MEG en 95 Hz et la courbe d’intensité affiche une crête de 4 unités verticales exactement soit 16,4 ampères à vide et en charge. Je note que le courant « moyen » affiché par l’ampèremètre du circuit d’alimentation est de 5 ampères. La tension aux bornes du relais statique est de 11,4 volts, vu la plus faible résistance de mesure insérée. Pour obtenir un test à plus de 12 volts aux bornes du relais statique je connecte l’élément de batterie de 2 volts et 200 Ah en série avec la batterie de 12 volts. La tension aux bornes du relais statique est désormais de 12,8 volts en charge et à vide pour le test en 95 Hz. Les résultats sont : En 95 Hz : crête de 17,2 ampères à vide et 18,4 ampères en charge. En 150 Hz : crête de 13,1 ampères à vide et 14,8 ampères en charge. En 200 Hz : crête de 11 ampères à vide et 14,4 ampères en charge. Je remarque que les crêtes d’intensité à vide et en charge « décrochent » de leur égalité D’autant plus que la fréquence augmente. Il y a peu j’avais fait une estimation du courant maximum passant dans le moment de la séquence de connexion ou la réactance était la plus basse. Je trouvais environ 20 ampères. Ce n’était pas très loin. Je note tout de même que ces crêtes sont l’aboutissement d’une pente très raide en FIN de séquence de coonexion. |
|
Ecrit le: Lundi 24 Mars 2008 à 15h01

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
24 MARS 2008 C Test sur la crête d’intensité et de tension sur la charge. Le plus important pour moi était de confirmer que la crête d’intensité sur la charge était située au début de la séquence de connexion alors que la crête d’intensité de consommation est située à la fin de la séquence de connexion. C’est chose faite. Je confirme donc que la crête d’intensité sur la charge est située au début de la séquence de connexion et que sa valeur est de14,7 ampères !! Au même instant la crête de tension sur cette même charge est de 62 volts !! Cela fait une puissance crête de 911 watts !! je rappelle qu’au même instant la consommation est de zéro watt… C’est violent et cela vient de « nulle part »… L’étalonnage est le même que pour les tests précédents. La consommation crête qui est située en fin de séquence de connexion est de 223 watts pour une identité de paramètres de mesure. La puissance « moyenne » produite observée par comparaison de brillance des ampoules est de 50 watts. A plus.... |
|
Ecrit le: Mercredi 26 Mars 2008 à 07h16

|
|
|
Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 956 Membre n°: 141 Inscrit le: 01/12/2005 |
LABO343 MEG
25 MARS 2008 Bonjour à tous. L’effet « ressort » Lorsque démarre la séquence de connexion en charge il y a production immédiate d’une puissance crête de 911 watts sans qu’il n’y ait aucune consommation au même instant. De plus la consommation crête est située à la fin de la séquence de connexion. Pour qu’il y ait un « effet ressort » il faut respecter un « ordre temporel des opérations ». Cela signifie qu’un ressort ne peut pas restituer une énergie qu’il n’a pas emmagasiné au préalable. Cela veut dire qu’il faut commencer par accumuler de l’énergie avant qu’elle soit restituable. La conséquence est qu’on peut exclure un quelconque « effet ressort » dans le test MEG. La puissance produite d’origine inconnue apparaît avant la puissance consommée. A plus... |
|
Ecrit le: Mercredi 26 Mars 2008 à 08h08

|
|
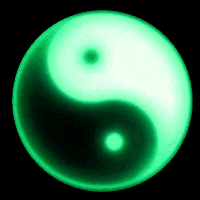 Expert(e)       Groupe: Membres Messages: 4296 Membre n°: 276 Inscrit le: 11/06/2007 |
Hello Tous, Hello Labo
Félicitations pour la persévérance !! Et yoouupppiiieee !! Il suffit donc, si j'ai bien compris de couper l'alimentation, juste après la crête de 911 watts fournis, pour reprendre un nouveau cycle de connexion ?? A plus Amateur confiant -------------------- Peuple de France, tranche dans le lard en sachant faire une addition des voix Vote à 100% pour Mélenchon, le seul qui parle de paix et de partage des richesses |
0 utilisateur(s) sur ce sujet (0 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres:
 Pages: (87) « Première ... 17 18 [19] 20 21 ... Dernière » Pages: (87) « Première ... 17 18 [19] 20 21 ... Dernière » |
   |
[ Script Execution time: 0.5273 ] [ 13 queries used ] [ GZIP activé ]




